FOCUS : TEEN APOCALYPSE TRILOGY de Gregg Araki
Un article de LUDOVIC SANCHES
©Desperate Pictures/UGC/Why Not Productions
Enfant de la Californie, né en 1959 à Los Angeles, Gregg Araki a beau commencer sa carrière tel un outsider en tournant un cinéma bricolé dans des conditions de guérilla, il n’est pas pour autant un autodidacte. Après avoir grandi à Santa Barbara, il intègre l’Université de la Californie du Sud et étudie le cinéma pour en ressortir diplômé en 1985. Cela se ressent des son premier film tourné pour 5000 dollars en noir et blanc avec sa propre caméra et des amis à lui.
Dans THREE BEWILDERED PEOPLE IN THE NIGHT (1987), on suit trois personnages qui errent dans la nuit et bavardent et se confient leurs problèmes existentiels dans un esprit très Nouvelle Vague française. Pour un peu, avec ces conversations qui s’éternisent, on se croirait dans LA MAMAN ET LA PUTAIN de Jean Eustache. Les scènes entrecoupées d’écrans noirs, les plans fixes et le noir et blanc évoquent STRANGER THAN PARADISE, le premier long de Jim Jarmusch tourné quelques années plus tôt, lui aussi avec un budget dérisoire. THE LONG WEEKEND (O’DESPAIR), tourné en 1989, est du même acabit. Dans ces films très personnels, on trouve toujours un personnage d’alter ego de jeune artiste ou de cinéaste gay en proie à des interrogations qui, on s’en doute, était celles d’Araki à l’époque. Son personnage principal y jette à la poubelle un bouquin du critique français André Bazin et déclare même que « le cinéma est mort« .
En 1992, Gregg Araki tourne THE LIVING END avec un budget de 20000 dollars. Un critique de cinéma apprend qu’il est positif au virus du SIDA et voit sa vie bouleversée quand il prend en stop un jeune type aussi beau que dangereux qui se balade avec une arme. Si Araki s’est déjà fait repérer dans des festivals avec ses précédents films, c’est avec celui-ci que son style émerge vraiment. Des le premier plan où le personnage de Luke tague la phrase « Fuck the world » sur un mur, on comprend que le spleen en noir et blanc va laisser sa place à une explosion de rage et de couleurs. Sous-titré « An irresponsible movie by Gregg Araki« , THE LIVING END se distingue par une surstylisation des images, un humour décalé et volontiers outrancier, un érotisme décomplexé et une crudité des dialogues, bref, une énergie cathartique qu’Araki oppose à l’époque, comme un doigt tendu à l’Amérique conformiste des années 90. Dans les années 80, le cinéma américain invente le blockbuster moderne et l’industrie du divertissement de masse se complait globalement dans la nostalgie et le manichéisme. L’alternative viendra du cinéma indépendant avec l’émergence de cinéastes comme Jarmusch, Hal Hartley, Richard Linklater, Quentin Tarantino. Araki sera même rattaché au New Queer Cinema avec des gens comme Gus Van Sant, Rose Troche ou Todd Haynes qui vont signer des films dont les représentations rompront avec l’hétéronormativité du cinéma mainstream.
Avec l’explosion de cette nouvelle vague du cinéma indépendant US autour notamment du festival de Sundance, le cinéma de Gregg Araki accède alors à une audience internationale. Par son insolence, sa liberté de ton, son humour potache et décapant, son indépendance farouche, Araki est un de ceux qui aura le mieux prolongé un certain esprit underground à travers son cinéma, ce qui en fait peut-être le digne héritier d’un John Waters qui est l’un de ses modèles. La voie était ouverte pour son œuvre la plus emblématique et la plus culte, la désormais fameuse TEEN APOCALYPSE TRILOGY.
Si les films d’Araki sont d’abord une réaction viscérale face à la peur du SIDA et aux faits divers évoquant des suicides chez les jeunes de la communauté gay, la TEEN APOCALYPSE TRILOGY va volontairement chercher son carburant du côté d’une certaine mythologie de la jeunesse américaine et de toute cette pop culture qui l’incarne. Des lors, c’est la jeunesse même qui devient sous la caméra d’Araki une apocalypse, toutes les expériences étant vécues comme une fin du monde possible, hantées par la possibilité de la mort et de la destruction. Cette mythologie va s’incarner dans des figures et d’abord dans celle de l’acteur James Duval dont Araki va se faire un alter ego.
Dans TOTALLY FUCKED UP (1993), il apparait des les premiers plans comme une icone avec sa coiffure, son blouson de cuir, ses lunettes noires, sa dégaine cool. A l’instar de Johnny Depp dans CRY BABY de John Waters ou de River Phoenix dans MY OWN PRIVATE IDAHO, James Duval fait partie de ces personnages qui invoquent dans le cinéma américain des années 90 la figure tutélaire de James Dean (dans THE LIVING END, la célèbre devise attribuée à Dean « Live fast, die young » est même citée par le héros du film). L’autre élément clé, c’est la musique. Accédant enfin à des budgets plus importants, Araki va pouvoir se permettre d’inonder ses films de son univers sonore et de la bande son d’une époque et s’en servir pour caractériser l’état d’esprit de ses personnages: James Duval porte un tee-shirt MINISTRY, le couple de filles écoute les COCTEAU TWINS (la B.O est pleine de morceaux issus du label 4AD) et une d’entre elles raconte qu’en Yougoslavie, ils voudraient interdire la musique de JOY DIVISION ou des SMITHS de peur qu’elle incite les jeunes à se suicider.

©Desperate Pictures
TOTALLY FUCKED UP est un peu la synthèse du cinéma d’Araki première manière. On y retrouve ce côté « journal intime », cette spontanéité. C’est, dira-t-il, son film le plus godardien. Du cinéma de Jean Luc Godard, il retient une certaine approche sociologique, un gout pour la rupture et la discontinuité, le collage d’images et de sons épars qui témoignent d’une époque. L’image de la pellicule 16mm se mélange avec la vidéo: des séquences filmées directement sur un écran de télé (ce qui leur donnent une texture bien particulière) dans lesquelles les personnages s’adressent à nous face caméra comme dans un documentaire. La parole restera un élément important du cinéma d’Araki, d’une manière ou d’une autre, il y a une volonté de donner aux personnages la possibilité de s’exprimer, des pouvoir les écouter sans les juger, quelques soient les sujets sur lesquels ils s’expriment des plus futiles aux plus crus, des plus triviaux aux plus graves. Araki est un des rares qui filment souvent les conversations d’après la baise. Là où une fois l’action terminée, le cinéma traditionnel passe souvent à autre chose, le lit devient ici propice à la confidence et on sent une vraie tendresse dans laquelle Araki filme ces instants de suspension.
C’est aussi le moment ou le personnage masculin laisse entrevoir une douceur et une fragilité bien loin d’une représentation archétypale des codes de la virilité. Reste que quand le monde extérieur s’invite, il constitue une menace et si l’une des filles de TOTALLY FUCKED UP s’indigne du « génocide soutenu par le gouvernement » qu’est l’épidémie du SIDA, il en ressort un véritable sentiment d’impuissance politique face à ce que le film appelle cyniquement « the decline of stupid fucking western civilization« .

©Desperate Pictures
Le sarcasme et l’humour, c’est donc justement ce que le film va opposer à ce désespoir ambiant. Dans TOTALLY FUCKED UP, ca passe par le montage et par l’insertion constante de cartons qui viennent introduire une distance ironique par rapport à ce que l’on regarde. Pendant une discussion sur les icones gay du showbiz, un carton vient qualifier Tom Cruise de « Rock Hudson des années 90« , dans une scène où les garçons décident de donner du sperme à leur copines lesbiennes pour qu’elles puissent tomber enceintes apparait un avertissement « Warning: kids, don’t try this at home » et quand à la moitié du film, un début d’intrigue semble enfin se dessiner, on voit apparaitre le signal « Start narrative here« . Ce gout de la potacherie et de la provocation passe aussi par l’insert d’images comme ce plan de film porno qui arrive comme un cheveux sur la soupe et par les dialogues souvent très drôles.
Le décalage vient du malin plaisir qu’a Araki à mettre des répliques improbables dans la bouche de ses acteurs au milieu d’un dialogue parfaitement candide: dans THE DOOM GENERATION (1995), face à Amy (Rose Mc Gowan) qui fait part de son envie de fuir de sa vie quotidienne, son petit copain Jordan (James Duval) lui avoue se sentir parfois comme « un hamster coincé dans le cul de Richard Gere« . Ce ton moqueur et cette dérision permanente est poussée toujours plus loin dans la trilogie, les films ne cessant de convoquer des clichés et de les utiliser comme tels dans un esprit camp et c’est ainsi que le naturalisme encore présent dans TOTALLY FUCKED UP va laisser place à une outrance et une artificialité de plus en plus revendiquée. L’ultime volet NOWHERE (1997) se présentant carrément comme une parodie de soap opera pour ados, le mélange entre les couches de documentaire, de réalité et de fiction qui constituait les différentes strates narratives de TOTALLY FUCKED UP a alors totalement disparu.

©UGC/Why Not Productions
Des les premiers plans de THE DOOM GENERATION, le générique annonçant « A heterosexual movie by Gregg Araki« , James Duval dansant convulsivement sur « Heresy » de NINE INCH NAILS, « Bienvenue en Enfer » écrit en lettres de feu et l’apparition en gros plan de Rose Mc Gowan lançant un « Fuck » blasé face caméra, on peut dire que le ton est donné. C’est le premier long métrage de Gregg Araki à être distribué en salles en France et pour cause c’est une coproduction française et c’est aussi un des plus gros budgets auquel aura eu accès Araki (800000 dollars pour un tournage en 35mm avec une équipe technique fournie) même si ce sera un échec commercial aux Etats Unis, avec des problèmes de censure imposée par le distributeur américain (la version qui sortira en vidéo la bas aurait été amputée de presque vingt minutes). Après une soirée en boite, Amy et Jordan rencontrent un certain Xavier qui, poursuivi par une bande de types, s’introduit dans leur voiture et leur demande de l’aider à fuir. A partir de là, le trio va enchainer les mauvaises rencontres et semer les cadavres sur leur passage.
Ce second volet de la trilogie s’inscrit alors clairement dans la tradition des films de cavale qui irait en gros de THEY LIVE BY NIGHT de Nicholas Ray (1947) à SAILOR & LULA de David Lynch (1990) en passant par BADLANDS de Terence Malick. Comme chez Nicholas Ray, les personnages errent dans une Amérique faite de lieux de passage: autoroutes, motels, diners, hangars désaffectés, des endroits qui reflètent leur inadaptation, le foyer, la maison, le monde des adultes, le monde réel pourrait-on dire (« tu trouves pas que la réalité est plus folle que les rêves » dira le personnage de Jordan) reste presque totalement hors champ. Ce sera encore plus évident dans NOWHERE où le monde de ces jeunes gens ressemble à un univers de fiction.

©UGC/Why Not Productions
Le triangle amoureux est un motif qui revient régulièrement dans le cinéma d’Araki, des son premier long métrage et il en donnera une version idéalisée et optimiste dans SPLENDOR en 1999. Chez Araki, le désir sexuel et la libido des personnages est un moteur à part entière du récit et de la narration au point d’influer sur la forme et le rythme du film (voir le montage parallèle en forme de crescendo orgasmique dans NOWHERE). Face à la mort omniprésente, le sexe exprime une pulsion vitale, cathartique et libératrice. Cet hédonisme décomplexé est une manière pour Araki de bousculer les représentations et les stéréotypes: le désir est souvent du côté des femmes qui assument leur sexualité sans aucune culpabilité tandis que les garçons font preuve de tendresse et de romantisme, dans une fluidité des désirs qui refuse les étiquettes (THE LIVING END s’attaquait à une normalisation de la représentation des gays dans les médias de manière assez provocante et dans TOTALLY FUCKED UP, les personnages expriment avec humour leur refus de se conformer à certains codes culturels).
Mais cet érotisme pulsionnel est aussi l’expression d’une sentimentalité réelle et très pure, un romantisme noir et fataliste comme quand James Duval embrasse fougueusement un autre garçon sur un capot de voiture après lui avoir raconté une horrible histoire d’une fille retrouvée dévorée par un requin sur une plage. Dans THE DOOM GENERATION, James Duval apporte sa candeur au personnage de Jordan avec un vrai sens comique, Johnathon Schaech campe le bad boy en plus trash et vulgaire et Rose McGowan casse son image de poupée sexy par un humour sarcastique à toute épreuve. Leur trio évoque la dynamique de celui de LA FUREUR DE VIVRE de Nicholas Ray (1955) mais dont l’homoérotisme latent (dans la relation entre Jim/James Dean et Platon/Sal Mineo) exploserait ici et se résout aussi tragiquement puisqu’au moment ou les trois personnages partagent leur plus grande complicité, une bande de néo-nazis viennent transformer leur nuit en cauchemar dans une scène d’une grande brutalité, succession de visions sanglantes et hallucinatoires dont les flashs infernaux évoquent la terrifiante mort de Laura Palmer dans FIRE WALK WITH ME (1992) de David Lynch, autre victime sacrifiée et figure de l’innocence perdue. A leur manière, Jordan, Amy et Xavier sont les « rebelles sans cause » de la génération X et des années SIDA.

©UGC/Why Not Productions
NOWHERE emprunte de manière encore plus évidente à une esthétique pop et plus précisément à une forme télévisuelle, celle des séries et du vidéo clip, en somme au style de MTV, la chaine musicale qui inventa aussi la télé réalité moderne (avec l’émission THE REAL WORLD des 1992) dont on retrouvait certains aspects dans TOTALLY FUCKED UP (par ailleurs Gregg Araki aura un projet de série télé avec MTV quelques années plus tard, mais la chaine décida d’annuler le projet et le pilote qui avait été tourné ne fut jamais diffusé). Son casting est en grande partie composés de jeunes stars du petit écran comme Shannen Doherty, Rachel True et Kathleen Robertson qui ont débuté dans BERVERLY HILLS 90210, Jordan Ladd dans SAUVES PAR LE GONG, Christina Applegate de MARIES, DEUX ENFANTS et va contribuer à révéler d’autres comédiens de la nouvelle génération (Heather Graham, Mena Suvari, Ryan Phillippe, Denise Richards…)
Les clichés des soap operas pour ados (avec entre autre la scène où la petite amie vient rendre visite au héros dans sa chambre en rentrant par la fenêtre, un grand classique) sont moins parodiés que passés à la moulinette d’une forme totalement survoltée en surrégime permanent: la profusion des personnages et des pistes narratives, mode de fonctionnement classique de la forme sérielle, est ici comme compressée pour créer un maelstrom visuel, entre le zapping furieux et le bad trip. Mais Araki ne se limite pas à un simple pastiche: il s’agit dans un premier temps de faire surgir la face cachée de ce monde, les forces qui l’animent, les pulsions sexuelles et vitales des personnages que la pudibonderie des productions télévisuelles mainstream tendent à laisser totalement hors champ, des puissances occultes mais qui forcément apparaissent sous leur incarnation la plus kitsch (un alien de série Z qui vaporise des ados avec un pistolet laser en plastoc) et les forces obscures et mortifères qui justement proviennent des écrans, comme ce beau gosse incarné par Jaason Simmons (un ancien d’ALERTE A MALIBU à qui Araki fait à peu de choses prés jouer son propre rôle) et qui cache en fait un violeur brutal.

©UGC/Why Not Productions
Dans NOWHERE, c’est comme si l’image télévisuelle avait fini par contaminer le réel au point de constituer la matière même de la psyché des personnages: les adultes sont montrés comme complètement abrutis devant leur télé et le décor semble refléter l’intériorité des héros (au passage, comment ne pas avoir envie d’avoir la même chambre d’ado que celle de James Duval dans ce film ?). Face à ce brouillage permanent entre le rêve et la réalité, le monde semble être devenu fou et les plus fragiles vont trouver refuge auprès dans l’image d’un évangéliste qui leur promet un paradis illusoire. Les deux jeunes gens comme en transe répètent les mots du prêcheur, dans un rapport d’addiction à l’image, la scène semblant anticiper sur l’image d’Ellen Burstyn absorbée par son émission de télé dans le REQUIEM FOR A DREAM de Darren Aronofsky trois ans plus tard. Cette chronique de l’adolescence (l’action de NOWHERE est censée durer 24 heures mais on a l’impression que la temporalité est complètement explosée) vécue comme une paroxysme permanent, constamment au bord de la catastrophe, enregistre le drame d’une génération qui n’est pas en train de perdre son innocence en basculant dans l’âge adulte mais qui en fait n’a même plus droit à cette innocence. La scène finale de NOWHERE enfonce le clou de l’esprit grinçant et désabusé de la trilogie: c’est comme un gag, une explosion de gore, potache et inattendue, a laquelle répond le regard perdu et désespéré de James Duval. Peut-être que ca ressemblera à ça la fin du monde si on est là pour la voir: on ne saura pas si il faut en rire ou en pleurer.
Passé le cap de la fin du millénaire, les images et les formes du cinéma d’Araki continue à infuser tout un pan de la culture pop, aussi bien du côté du cinéma d’auteur que de la production mainstream. Le lien entre l’adolescence et l’apocalypse s’est même radicalisé dans tout un imaginaire de la fiction contemporaine et il faudrait voir ce qui reste des films d’Araki à notre époque qui semble presque déjà relever d’un temps d’après la catastrophe. Plus qu’un instantané des années 90, le cinéma de Gregg Araki semble avoir utilisé la mythologie de l’adolescence et le spectre de la fin de monde pour en faire une expression de la liberté, une liberté qui, sur le plan cinématographique, constitue un contrepoint toujours vivace face au formatage toujours plus flagrant d’une grande partie de la production actuelle.

©UGC/Why Not Productions
La BO du jour:
RIDE – Leave Them All Behind
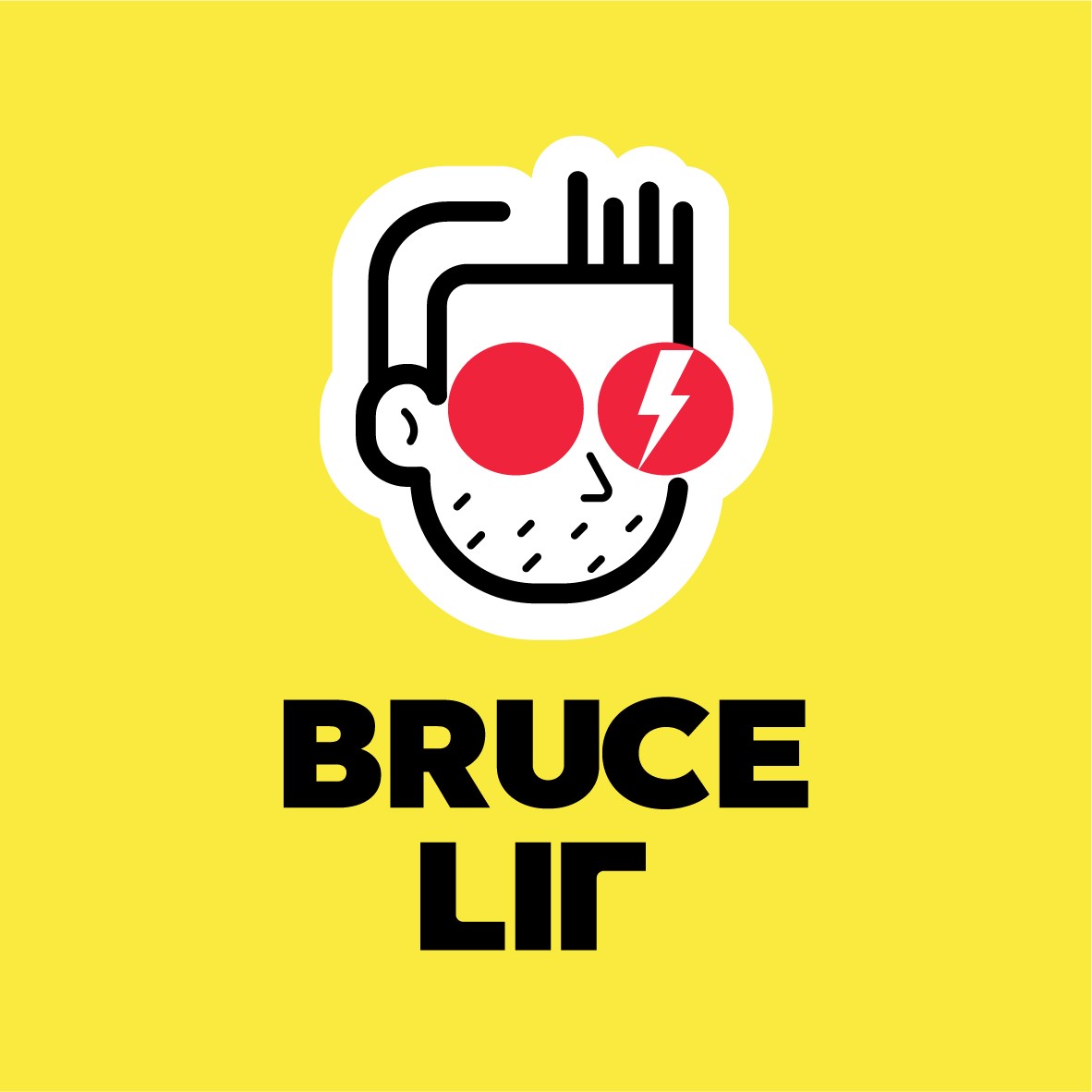
Merci pour cette exploration d’un cinéma que je ne connais pratiquement pas. Tout juste ai-je aperçu (cad écouté plus que vu, en jouant sur l’ordi en même temps) The Doom Generation durant l’ère des vidéoclubs, avec son parfum d’apocalypse (des 666 dans tous les coins, dans mes souvenirs ?) et ses scènes de sexe/violence épileptiques.
Merci JB !
Pas vu mais écouté, c’est déjà pas mal vu que la bande son des films d’Araki, c’est quand même quelque chose ! 🙂
Je n’ai jamais trouvé Totally..
Tu parles peu de Slowdive qui est omnip^résent dans ses films (générique de fin de Doom et de début de Nowhere) et sera trés important sur Mysterious Skin.
Les films d’Arraki ont à mon avis permis à Slowdive de passer les decennies malgré le fait que les journalistes de rock de l’époque les auront bien explosés.
Je m’éloigne du sujet mais c’est une des choses qui font que j’aime toujours le cinéma de Arraki qui a un peu vieilli.
Récemment, Alexis Langlois s’est inspiré de son outrance dans les reines du drame même si on est loin du cynisme et du désespoir de Arakki.
Pour moi il reste trés lié àKevin Smith car Doom et Clerks soint sortis au cinéma dans les mêmes années. Je trouve qu’il y a chez eux deux des dialogues un peu à la Tarantino mais Arraki est foncièrement non réaliste, trés musical (scene shoegaze/dream pop/Indus US) mais aussi avec le même sens pop culture. Comme Kevin Smith il ne gravira jamais la derniere marche et reviendra ensuite à des films plus oubliables (smiley face) même si j ai un bon souvenir de White Bird.
Mais bon j ai jamais trouvé les films précédant Doom Generation…
There is no place for us in this world (le CD de la BO de Doom Generation commencait avec cette tirade et conti,et un remix superbe de Lush)
Je crois que quand Heresy est joué au début c’est Skinny Puppy qui est sur scène
Merci pour ton commentaire Fred !
oui j’ai essayé de pas trop digresser sur la musique, il y avait tant de choses à dire, c’est clair que Slowdive, c’est LE groupe de l’univers de Gregg Araki, même dans sa récente série télé NOW APOCALYPSE, il peux pas s’en empêcher, paf il met du Slowdive !
TOTALLY FUCKED UP était sorti en DVD en zone 2 (ainsi que THE LIVING END) chez un petit éditeur mais aujourd’hui je suis pas sur que ce soit encore trouvable…
L’année dernière, les trois films de la trilogie ont été restaurés en 4K et ont été réedités en BluRay chez Criterion donc on peut espérer une édition française bientôt, croisons les doigts…
Les deux premiers longs métrages d’Araki ne sont visibles, eux, qu’en copies pirates de très mauvaises qualités…
Wouaw, superbe texte sur la période 90’s de Gregg Araki et en filigrane une certaine idée du cinéma indépendant américain de l’époque, qui me branchait beaucoup.
Comme tu le précises bien, j’associe moi aussi Araki à la génération MTV. J’avais à l’époque une amie qui était fondue d’Araki et qui ne jurait que par l’émission 120 minutes de MTV (l’émission indé de la chaîne). Moi, j’étais un peu au-delà de ça. Le mercantilisme de MTV me dérangeait déjà et je n’avais pas eu besoin de la chaîne pour découvrir le rock underground et le cinéma indie américains. Je crois que ça a joué sur ma perception d’Araki, dont je n’ai plus aujourd’hui qu’un souvenir assez diffus de The doom generation.
Faudrait que je me replonge dans sa filmo mais je ne sais pas trop si j’en ai vraiment envie. Alors que, par exemple, j’ai revu récemment My own private Idaho et que je trouve toujours aujourd’hui le film aussi magnifique qu’à l’époque où je l’ai découvert.
Comme Fred plus haut, j’associe aussi Araki à Kevin Smith et à son Clerks, même si je pense qu’Araki est un cinéaste beaucoup plus intéressant que Smith, qui n’est plus aujourd’hui à mes yeux qu’une baudruche qui s’est très rapidement complètement dégonflée.
La BO : je ne sais pas si c’est le cas pour vous mais moi chaque matin je me réveille avec une chanson en tête. Et aujourd’hui, c’était Vapour trail de Ride. Drôle de coïncidence.
J’adorais le groupe à ses débuts (les premiers EPs et le premier album éponyme avec sa superbe cover de vague) ainsi que tous les groupes du label Creation. A l’époque par chez moi on n’appelait pas encore ça shoegaze, non, c’était juste de la noisy pop et j’étais à fond dedans. En un peu plus d’un an, j’ai vu Ride quatre fois en concert.
J’ai revu récemment Doom Generation et je l ai trouvé un peu daté.
Jepense que Mysterious Skin doit avoir moins vieilli. Je pense que White Bird tientbien. En même temps ce sont des films plus normalisés. C est un peu le meurtre à Oxford d Alex de la Iglesia et ca perd un peu justement de tout l’attrait que ca a au départ. Je suis tombé par hasard sur Smiley que j ai pas aimé du tout et qui m a fait pensé aux Kevin Smith des années 2000 où t as beau retrouver un peu la patte ca tombe à l eau.
Cepedant quand je regarde la filmo j ai un bon souvenir de Kaboom… qui pourtant,il me semble est trés Nowhere.
Oui on appelait ca la noisy à l’époque mais aprés entre unpeu la noisy US et lanoisi française, qui n avaient tous rien à voir les uns avec les autres…. Bon moi je suis team Slowdive.
J ai été assez déçu par l histoire de creation comme on la voit dans Upside Down (docu sur le label)mais oui à l’époque (avant oasis, j etais aussi à fond sur le label)
Bon, on va essayer de pas trop digresser musique mais mon problème avec Slowdive, c’est que je n’ai jamais retrouvé chez eux la magie que j’avais trouvée dans leurs premiers eps (Slowdive, Morningrise et Catch your breath).
Je préférais Ride, Lush, Pale Saints et surtout évidemment My Bloody Valentine.
Mais bon, après Loveless, c’était plié. Y avait plus rien à ajouter. Et plus rien de majeur n’est sorti de ce mouvement musical. En gros, y a eu plein de bons disque mais ça a duré de 1988 à 1991.
Dans le revival il y a des bonnes choses, surtout DIIV mais The Pain of Being Pure at Heart ou d’autres ont sortis de bons trucs. DIIV je trouve qu’ils sortent des albums intéressants (pour moi plus que des groupes reconnus de 88 à 91)
S’il y a un mot que je n’aime pas, c’est revival.
Fuck revivals. 🙂
Merci Zen Arcade pour tes compliments et ton long commentaire !
J’ai encore beaucoup d’affection pour ce cinéma, cette période aussi, tu parles de Gus Van Sant, Fred parle de Kevin Smith, il a raison, j’ai encore beaucoup de tendresse pour ses premiers long métrages, la musique qui va avec aussi…
Je trouve que les films d’Araki ont quand même bien tenu le coup et il infuse pas mal de trucs qu’on voit aujourd’hui (Fred parle d’Alexis Langlois, je pense aussi à Yann Gonzalez) et peut etre que je ferai une suite à cet article pour parler des films d’après: MYSTERIOUS SKIN effectivement mais même KABOOM et WHITE BIRD, c’est quand même pas rien (il a eu le bon gout d’adapter Laura Kasischke quand même !)…
Sur le lien avec MTV (qui avait une place particulière quand même à l’époque, c’est pareil quand ils sont allés chercher des gens issus de la BD alternative pour créer certains programmes), finalement la collaboration avec Araki a été avortée, mais qu’il se nourrisse aussi de cette imagerie pour créer son style, c’est un aspect assez passionnant je trouve… j’aime l’idée qu’un style puisse avoir quelque chose d’impur et qu’un cinéaste absorbe des choses pas forcément nobles et sans forcément se retrancher dans une posture critique ou systématiquement ironique…
… Le nom me disait quelque chose, mais je ne reconnaissais aucun des films mentionnés dans l’article : c’est un univers qui semble à des kilomètres de moi, ce que je viens d’y lire -mais c’est d’autant plus informatif.
Heureusement que Mysterious Skin a été nommé, dans les commentaires : claquasse, en ce qui me concerne ; mais je crois me souvenir que c’est l’adaptation d’un bouquin autobiographique. C’est peut-être sa trame « classique » qui a fait que j’ai fonctionné : je l’ai trouvé très pile-poil/juste, alors que pas évident du tout à mettre en scène. Les partis-pris (surréalistes et/ou oniriques) passent bien et aident à encaisser le sujet, autrement très duraille.
oui, c’est ça Bruno , MYSTERIOUS SKIN était l’adaptation d’un roman de Scott Heim, mais le film est vraiment empreint totalement du style et des préoccupations de Gregg Araki, c’est un film aussi personnel que les autres si ce n’est qu’il met en retrait son humour et son gout pour la provocation pour coller aux affects des personnages et à leur drame. Je ne l’ai pas revu depuis longtemps mais j’en ai un souvenir trés marquant comme toi !
Le retour de Ludovic Sanchez : toujours aussi passionnant dans la visite guidée d’une œuvre que je ne connais pas, une dissection éclairante et généreuse.
Une réaction viscérale face à la peur du SIDA et aux faits divers évoquant des suicides chez les jeunes de la communauté gay : je suis toujours admiratif du spectateur capable de prendre le recul nécessaire pour saisir le thème directeur d’un film, l’actualité sociétale qu’il recèle.
Il y a une volonté de donner aux personnages la possibilité de s’exprimer, des pouvoir les écouter sans les juger, quelques soient les sujets sur lesquels ils s’expriment des plus futiles aux plus crus, des plus triviaux aux plus graves. – Un choix courageux, car longtemps il m’a semblé que la simple discussion constitue une réduction du potentiel du média qu’est le cinéma, une utilisation pauvre de ses possibilités, un peu l’équivalent d’une suite de cases de BD avec uniquement des têtes en train de parler.
The decline of western civilization : une référence au documentaire (1981) de Penelope Spheeris ?
Le personnage masculin laisse entrevoir une douceur et une fragilité bien loin d’une représentation archétypale des codes de la virilité : un personnage déconstruit avant l’heure ? 😀 C’est une taquinerie il y a eu des personnages dont la masculinité d’exprimait autrement avant.
Disparition des strates narratives : voilà une démarche qui fait penser à celle du nouveau roman, une véritable aventure artistique.
Une Amérique faite de lieux de passage : autoroutes, motels, diners, hangars désaffectés, des endroits qui reflètent leur inadaptation, le foyer, la maison, le monde des adultes. – Intéressant comme représentation de l’Amérique, déjà une société de flux où l’individu dérive sans possibilité d’ancrage.
Une forme totalement survoltée en surrégime permanent : la profusion des personnages et des pistes narratives, mode de fonctionnement classique de la forme sérielle, est ici comme compressée pour créer un maelstrom visuel, entre le zapping furieux et le bad trip – Hé ben ça doit être un peu éprouvant comme visionnage pour un spectateur non averti ?
Comme si l’image télévisuelle avait fini par contaminer le réel au point de constituer la matière même de la psyché des personnages – J’aime beaucoup cette notion. En ces temps de société du spectacle qui présente tout et n’importe quoi dans une forme conflictuelle (oui je pense à des chaînes d’opinion), je me surprends parfois à me comporter comme si ces arguties agressives avaient contaminé ma psyché.
Merci beaucoup pour ces découvertes et ce regard analytique et sensible.