Walking Dead, Tome 8 – Une vie de souffrance par Robert Kirkman & Charlie Adlard
PRESENCE
VO : Image Comics
VF : Delcourt
Ce tome fait suite à Dans l’œil du cyclone (épisodes 37 à 42) qu’il faut avoir lu avant. Il comprend les épisodes 43 à 48, initialement parus en 2007/2008, écrits par Robert Kirkman, dessinés et encrés par Charlie Adlard, avec des trames grises appliquées par Cliff Rathburn.
–
– ATTENTION – Ce commentaire dévoile des points de l’intrigue du tome précédent. –
Le début de ce tome raconte ce qu’il est advenu de Philip Blake (le Gouverneur) après que Rick Grimes et les autres se soient enfuis de Woodbury. Il est retrouvé dans un état pitoyable par Bruce Cooper (son bras droit, un grand chauve) et Gabe (Gabriel Harris, son fidèle second). Bruce fait appel à Bob Stookey pour le prendre en charge. Le Gouverneur finit par s’adresser aux habitants de Woodbury, en donnant sa version, ou plutôt son interprétation déformée et amplifiée du passage des habitants de la prison. Il doit aussi s’occuper du problème dentaire de sa fille Penny. Par la suite il doit encore gérer les conséquences de l’expédition de Glenn, Maggie, Tyreese, Michonne, Andrea et Axe, dans la base locale de la Garde Nationale.
L’assaut est donné sur la prison de la communauté de Rick Grimes, par les forces armées (avec même un tank) du Gouverneur. Malgré les jours écoulés depuis l’évasion de Woodbury, la préparation de la petite communauté laisse à désirer. L’agglutination de zombies contre les grillages se révèle plutôt efficace, et les tireurs d’élites dans les tours de guet aussi. Mais les forces du gouverneur disposent d’une puissance de feu supérieure, et elles surprennent les habitants à découvert, à l’extérieur de la prison. En outre, d’un côté, il y a des hommes prêts à en découdre et à tirer sur tout ce qui bouge (suite à la harangue du Gouverneur) ; de l’autre côté, il y a des individus moyennement armés, des femmes et des enfants. Tout peut arriver.
Depuis la découverte initiale de la communauté de Woodbury (et l’accueil reçu), le lecteur avait la ferme conviction que la confrontation serait inéluctable, sous la forme d’une attaque menée par les troupes du Gouverneur. La dernière page du tome précédent ne laissait place à aucun doute, avec un dessin en pleine page présentant un degré d’explicitation maximum, réalisé par des experts dans l’absence de nuance. Quel que soit son degré de cynisme et le nombre de divulgâcheurs qu’il a pu voir, le lecteur est pris aux tripes et éprouve une empathie pleine et entière pour les membres de la communauté de la prison. Il a appris à connaître les uns et les autres, à savoir qui est capable de se battre, qui ne l’est pas, et même quels combattants sont plus ou moins expérimentés. Il sait aussi par avance que Robert Kirkman respectera avant tout le principe de base de la série : seul Rick Grimes est irremplaçable, et encore pas forcément entier. Même en sachant qu’il y a encore plusieurs tomes à lire après, le suspense reste entier.
Le scénariste joue sur l’un des ressorts les plus basiques : qui va mourir ? En même temps, le lecteur sait que les morts ne reviendront pas à la vie (si ce n’est sous forme de zombie) et que tout ce qui a été patiemment construit pendant les tomes précédents peut se retrouver réduit à néant. Il sait aussi que les auteurs ne sont pas tendre avec leurs personnages, surtout si le niveau de sadisme peut augmenter les ventes, en choquant le lecteur se disant qu’ils n’ont quand même pas osé faire ça (et ben si, et même plus cruel encore).
Robert Kirkman fait monter la tension avec le premier épisode en montrant ce à quoi s’est occupé le Gouverneur. Au travers de ses actions, le lecteur mesure à quel point Philip Blake vit dans son propre monde, agissant suivant sa logique tordue, comme un psychopathe incapable d’empathie. Effectivement, ce premier épisode confirme les pires craintes du lecteur. Robert Kirkman construit avec application et conviction un individu sadique et immoral. Le lecteur peut trouver qu’il ne s’agit que d’un artifice pour attester d’à quel point la communauté de la prison est en danger de mort. Il peut aussi se souvenir qu’à plusieurs reprises le récit s’est attardé sur le poids psychique que fait peser l’effondrement de la société et le regard permanent des zombies, et sur les différentes stratégies psychiques mises en œuvre par les personnages pour vivre avec ce traumatisme, à commencer par Carol et Michonne, chacune de manière différente. Il est donc certain que le Gouverneur ne reculera devant aucune horreur pour exterminer ceux d’en face.
Effectivement, le massacre attendu a bien lieu, et bien pire que tout ce que le lecteur pouvait redouter. Robert Kirkman ne fait pas de quartier, et les dessins de Charlie Adlard sont toujours aussi factuels et efficaces, avec une dramatisation appuyée pour chaque horreur. La cervelle des zombies vole et coule. Les blessures par balle provoquent des épanchements plus ou moins importants de sang et parfois emmènent un petit bout de chair ou d’os du crâne. Les visages et les vêtements sont marqués par des tâches grises correspondant à du sang séché. Les bandages sont d’une propreté douteuse. Les individus tabassés ont un visage tuméfié et des dents manquantes. Ce n’est pas une partie de plaisir et le dessinateur ne fait pas semblant. Encore qu’il ne se complaise pas dans le détail photographique, il préfère les zones aux contours un peu flous qui donnent l’impression de la marque des coups ou de l’impact des balles.
Le scénariste a conçu une attaque à l’échelle des 2 factions en place, avec des revers de fortune, des limites de capacité d’attaque ou de défense, des stratégies plus ou moins pensées qui se heurtent à des impondérables imprévisibles. L’arbitraire règne en maître, et personne n’est à l’abri. Bien sûr le lecteur cynique peut se dire que Robert Kirkman fait le ménage parmi les personnages qui étaient autant de frein à l’évolution de la situation, au renouvellement de la dynamique de l’équipe, et c’est sûrement vrai. Bien sûr, il peut encore s’agacer de la mise en scène qui veut que chaque fois qu’il y a un blessé ou un mort dans l’équipe de Rick Grimes, la case correspondante est plus grande que les autres, jusqu’à aller à une pleine page, et l’angle de prise de vue est choisi pour son effet dramatique appuyé. Mais ce n’est pas nouveau dans la narration visuelle, le lecteur sait qu’il doit s’attendre à ses artifices. Même si les éclairs de lumière des canons des armes à feu à chaque tir semblent trop photogéniques pour être honnêtes, la mise en scène est d’une clarté remarquable et impulse un rythme de lecture soutenu et même haletant.
Quelles que soient ses réticences et la qualité de son regard critique, le lecteur se sent complètement immergé dans ce face à face de 2 communautés, sur le mode duel au soleil et il n’en restera qu’un. Même si les images jouent sur une dramatisation racoleuse, et le récit se complaît dans les morts choc et faciles, l’impact émotionnel est bien présent. Tant la mise en scène que l’enchaînement des différentes phases de l’affrontement sont bien pensés, dans un déroulement logique et implacable. Le lecteur ressort de ce tome lessivé, effrayé par le déchaînement de violence aveugle, de sadisme barbare, de coût en vies humaines, de sentiment de perte d’amis qu’il avait appris à connaître. Même en ayant conscience que les auteurs jouent avec ses sentiments, et instrumentalisent la violence et les morts pour plus d’impact, il est impossible de décrocher de la lecture jusqu’à la fin, ou d’estimer que le fond de l’histoire repose sur intention narrative malhonnête.
Totalement abruti par la violence de l’affrontement, le lecteur peut ne pas remarquer que Robert Kirkman continue d’exploiter le filon de ses thèmes de prédilection. Il y a donc l’effet psychologique que peut avoir le fait de voir son quotidien partir en capilotade et de vivre sous le regard des morts à chaque instant, de ne plus pouvoir être en mesure de ne pas penser à la mort inéluctable, à la tombe qui nous attend tous. Avec ce traumatisme sans cesse rappelé, le lecteur finit par croire que les symptômes de folie de Philip Blake sont aussi ceux d’une adaptation à un monde qui s’est écroulé et dans lequel toutes les valeurs humanistes et morales n’ont plus de sens.
Au travers de sa distribution de personnages, l’auteur montre d’autres formes d’adaptation, de la panique pour certains, jusqu’à la résilience pour d’autres. Le lecteur peut à nouveau sourire devant le besoin irrépressible de certains de trouver du réconfort dans l’acte sexuel, d’éprouver la sensation de vie à travers l’accouplement. Mais dans ce tome, ce comportement n’est le fait que d’un seul couple, et reprend du sens, par comparaison à d’autres tomes où il était quasiment généralisé.
La dimension politique reste également très prégnante. Encore une fois se pose la question de qui décide, dans quelle condition et qui choisit pour le bien commun. Robert Kirkman donne une version simplifiée dans le mode de gouvernance pour la communauté de Woodbury. De par son charisme et ses résultats, le Gouverneur a su imposer sa position de chef et l’asseoir avec la fourniture d’une forme de pains et de jeux (Panem et circenses). Atterré, le lecteur observe les niveaux intermédiaires de la hiérarchie mettre tout en œuvre pour conserver le statu quo, quelles que soient les aberrations dans le comportement de leur chef. Pour une fois, le scénariste fait dans le sous-entendu, en laissant le lecteur imaginer les motivations des sous-fifres. De l’autre côté, la remise en question de la survie de la communauté de la prison remet aussi en question l’allégeance des uns et des autres. La question se repose de savoir quelle est la priorité et quelle sont les comportements qui sont à même de servir cette priorité.
Lorsque l’avenir est incertain, que les acquis sont remis en cause, il devient légitime de remettre en cause le système, de savoir ce qui passe en premier, et d’adapter son comportement en conséquence. Alors même que cette réévaluation de la situation et des stratégies est légitime, sa mise en pratique fend le cœur du lecteur. Il voit que les investissements effectués sont remis en cause, que le chacun pour soi reprend le dessus, au risque de perdre tout le bénéfice desdits investissements. De façon inéluctable, l’intérêt personnel reprend le dessus sur l’intérêt commun, sur l’intérêt public. À nouveau, le lecteur apprécie les qualités de l’artiste qui compose des expressions de visages torturées rendant compte du tourment intérieur des personnages, de leur déchirement entre des valeurs incompatibles, des investissements émotionnels irréconciliables. Autant les gros plans du visage de Rick Grimes frappé de stupeur sont répétitifs et surjoués, autant ceux des individus devant choisir de rester jusqu’à l’issue (très) incertaine du combat, ou de fuir avec une réelle chance de réussite, sont convaincants et émouvants.
Robert Kirkman développe aussi la manière dont la force de conviction d’un individu peut emmener tout un groupe derrière lui. À nouveau les dessins de Charlie Adlard montrent toute la fougue de Philip Blake quand il s’adresse à groupe. Il y a là une critique acerbe de la propension de certains individus à adopter un comportement de moutons et d’abandonner tout sens critique pour croire en un meneur, en un individu qui leur propose une vision simplifiée et donc plus rassurante du monde. Loin d’être improbable, ce comportement évoque des expériences de sociologie comme celles de Stanley Milgram et Philip Zimbardo. L’auteur emmène sa vision jusqu’à son terme, indiquant que seul un acte irréparable permet de briser la mainmise de tels meneurs, en l’occurrence l’exécution abjecte commise par Lilly Caul.
Dans cette peinture très sombre des pires travers de la condition humaine et de la fragilité de la démocratie, les respirations comiques sont rares et se comptent sur les doigts d’une main. Elles vont d’un gag récurrent ras les pâquerettes (un individu en train de se soulager, juste avant une découverte de taille, comme Axel dans le tome précédent), à un sarcasme de nature culturel, le Gouverneur méprisant face à Gabe qui ne comprend pas la référence à la légende allemande du joueur de flute de Hamelin (Der Rattenfänger von Hameln).
Le lecteur qui se prépare à aborder ce tome abandonne tout espoir. Robert Kirkman et Charlie Adlard mettent à profit toute leur science du sadisme pour faire subir les pires épreuves à leurs personnages. Le plat de résistance de ce tome était annoncé dans le précédent : la confrontation entre les 2 communautés voisines. Le lecteur sait très bien ce qui l’attend, et pourtant il n’y est absolument pas préparé. Les auteurs réussissent l’exploit de prendre le lecteur au dépourvu (même le plus blasé) dans le cadre pourtant très contraint d’une série mensuelle illimitée. Charlie Adlard continue d’affiner ses dessins en améliorant le dosage entre les détails et les zones plus brutes et primaires, oscillant entre les images à la dramatisation exagérée (on n’est jamais trop prudent pour s’assurer que le lecteur comprenne bien l’importance d’un événement) et l’efficacité primale. Robert Kirkman tire tout le profit possible du principe de sa série : seul Rick Grimes est assuré de survivre d’un tome à l’autre (et encore pas forcément en bon état), tous les autres sont des morts en sursis, ou des zombies en sursis. Sur cette trame aussi simple qu’efficace, les auteurs tiennent le lecteur en haleine sur le rebord de son siège, continuellement en train de se dire : non, ils ne vont quand même pas oser faire ça. Non seulement, ils osent, mais en plus c’est pire que prévu, et en prime ça offre un deuxième niveau de lecture dans des directions multiples.
——
L’arc qui traumatisa tous les lecteurs de Walking Dead à la une de Bruce LIt, 13 ans après sa sortie ? Oui, mais l’analyse de Présence vaut son pesant de cacahuète. The WAlking Dead Revisited à la une de Bruce Lit.
La BO du jour : A l’assaut
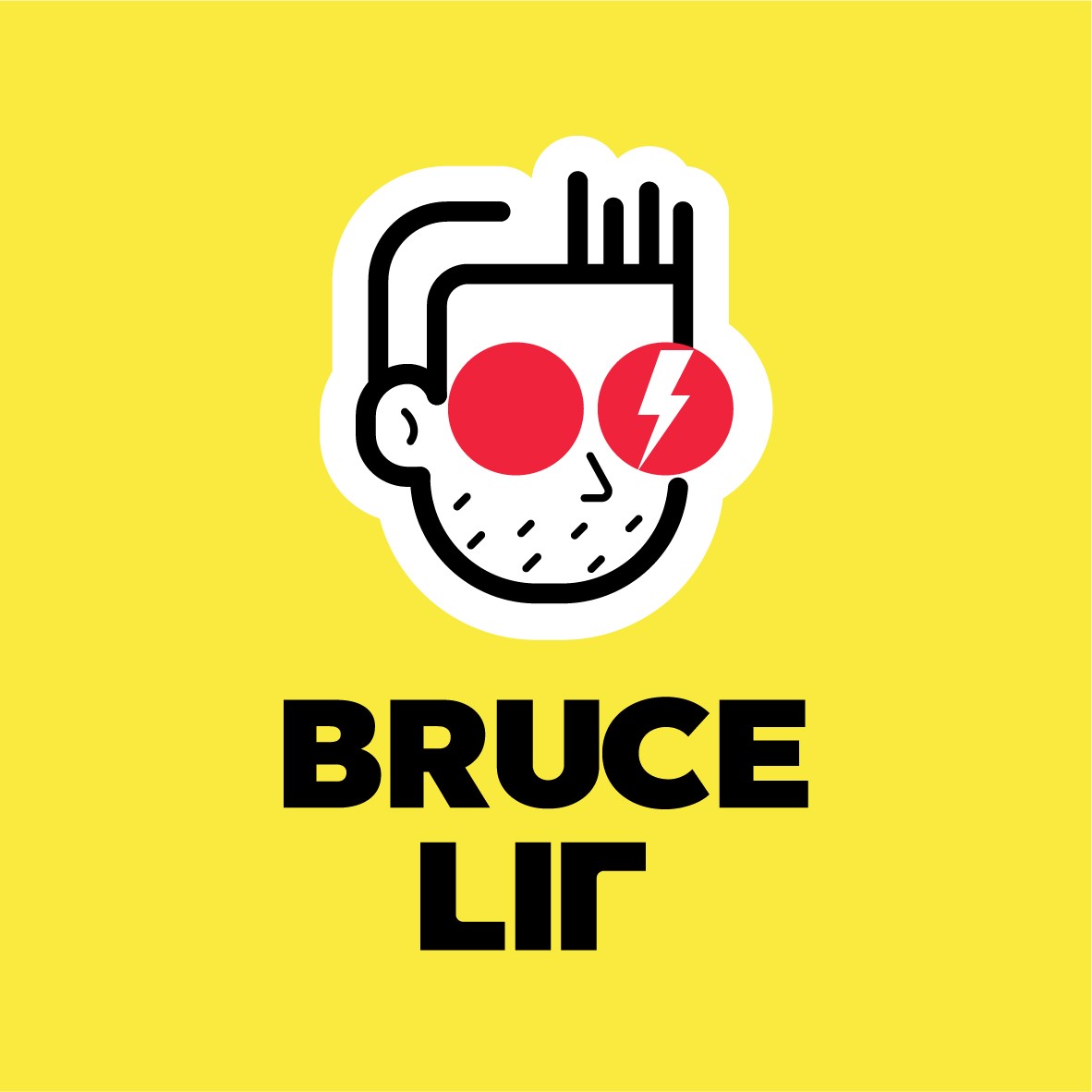
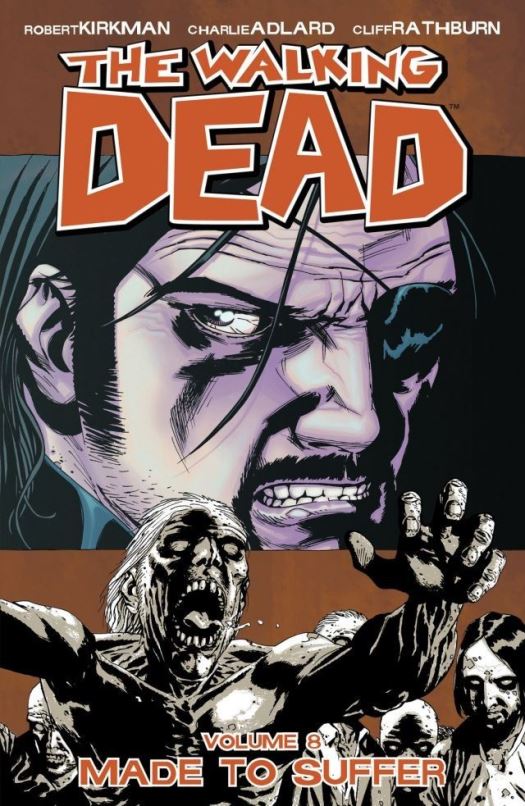





Hello,
Bravo pour cet excellent article fouillé et bien écrit. On s’y croirait !
En établissant un parallèle avec la série télé, je me posais souvent la question de savoir si c’est bien ainsi que se comporteraient une partie des êtres humains dans une société en déliquescence. Chacun pour soi sans aucune morale avec ses meneurs et ses suiveurs. Et ton article en fait bien le point…
Merci beaucoup pour ce retour très gentil.
Je suis toujours aussi impressionné par tout ce que tu arrives à sortir de la lecture d’un album. Et ici, en plus, on te sent emporté par la fougue du récit et par son intensité !
« les images jouent sur une dramatisation racoleuse » :
Ce thème revient en boucle dans presque tous tes commentaires sur cette série.
Mais n’est-ce pas le jeu de ce médium de se servir de ce qui fonctionne efficacement ? Tu réponds d’ailleurs par l’affirmative à cette question, en disant que le lecteur, malgré les artifices racoleur, accepte le procédé.
Il y a peu de temps, j’assistais à un stage de formation sur le cinéma et le maitre de conférence critiquait sévèrement le cinéma de Spielberg qu’il accusait d’être extrêmement racoleur (pour ne pas dire sirupeux). Il citait notamment un scène de la Liste de Schindler où tout était fait pour nous mettre la larme à l’oeil et disait à propos du travail de Spielberg qu’il était putassier d’utiliser de telle méthodes !
Il y a peu également, Jean-Michel Jarre citait Thodor Adorno qui disait quelque chose comme « Tout plaisir dans la musique est suspect« . Etant donné que le sujet me passionne, parce que personnellement je suis attaché à penser exactement le contraire (je n’écoute de la musique QUE si elle me procure du plaisir), je suis aller lire un peu les théories d’Adorno (principal philosophe musicologue du XX° siècle), et j’ai découvert que ce courant de pensée, qui perdure encore fortement aujourd’hui (le dogme du musicalement correct et du rock intègre propre aux irrockuptibles ne fait rien d’autre que véhiculer cette pensée), est né au lendemain de la 2nde guerre mondiale, d’un refus du romantisme musical qui avait été l’apanage du nazisme. Pour les musiciens d’après guerre, tout ce qui était lyrique, romantique et entrainant avait surtout servi à glorifier la montée du nazisme et de la pensée arienne. Il fallait donc balayer cet « humanisme dégénéré » qui avait fait du « plaisir sonore » une arme de propagande.
Pourquoi je digresse autant ? Et bien parce que je me rends compte qu’un dogme en a remplacé un autre avec le temps.
Aujourd’hui on n’a plus le droit d’aimer ce qui est simple et agréable. Il faut que ça soit forcément tordu et complexe pour être adoubé par l’élite.
Faire pleurer le spectateur avec une scène larmoyante ? Moi j’appelle ça du cinéma.
Donner le frisson avec une mélodie mélancolique gorgée de violons langoureux ? Moi j’appelle ça du plaisir.
Dessiner une planche de BD où la mise en scène et le cadrage amplifient l’impression sur le lecteur ? Moi j’appelle ça de l’efficacité.
Est-ce que c’est facile ? Je suis convaincu du contraire. Je pense qu’il est très difficile de faire simple et efficace. C’est au contraire beaucoup plus facile de faire quelque chose d’opaque et de le justifier par du blabla ensuite.
Toutefois, le danger du plaisir simple est sans doute une réalité puisque le nazisme est né dans le coeur de l’humanisme et de la culture dans l’un des pays les plus avancés et élitistes de notre histoire. Aussi est-il important d’apprendre, de comprendre comment ça fonctionne. Il faut être curieux, connaitre un maximum de choses. Savoir pourquoi ou comment on a fait de telles oeuvres. Connaitre l’histoire et la Shoa. Prévenir plutôt que guérir. Savoir que tout ne se vaut pas.
Au bout du compte, quand on sait faire la part des choses, on peut aimer et apprécier autant les choses simples que les plus complexes. On peut aimer les illustrations autant que les oeuvres de maîtres tout en sachant laquelle a le plus de valeur artistique, idem pour la musique et le cinéma où tout ne se vaut pas mais où on peut aimer se divertir autant que se cultiver.
Enfin, je digresse encore, mais pour moi les choses simples et efficaces, le plaisir immédiat, je pense qu’il est temps de l’accepter de nouveau. Ça fait partie du jeu et du médium. C’est du savoir-faire. C’est postmoderne.
La scène de Spielberg : tu parles de la fameuse scène de la douche ?
Je sais plus. C’est une scène larmoyante avec une petite fille, ou une jeune fille, je sais plus. Il m’a gonflé le conférencier sur ce coup là. Je ne suis pas intervenu parce que ce n’est pas mon genre, mais oui, j’avais envie de lui dire : « ben… c’est du cinéma, non ? ».
Merci pour cette ouverture aussi inattendue que passionnante.
Je ne connaissais pas les théories de Theodor Adorno que je découvre donc ici avec plaisir. Comme toi, je pense qu’il est très difficile de faire simple et efficace. Je sais aussi que la critique est facile et que l’art est difficile.
Quand je regarde les dessins de Charlie Adlard, j’ai l’impression de voir les raccourcis qu’il utilise pour dessiner rapidement, des décors qui ne sont parfois que des toiles tendues en fond de case avec des raccords bancals, des plans de prise de vue qui se répètent. Mais comme tu le fais observer, ça ne m’empêche pas d’apprécier cette lecture pour son efficacité, une fois que j’ai accepté de mettre mes attentes préconçues de côté, et de regarder vraiment ce qu’il y a sur la page. Je pense que mon volume de lecture entre également en jeu dans mon ressenti. J’ai parfois l’impression de retrouver des clichés visuels.
Il me semble qu’il se produit également une forme de dissonance cognitive dans mon cerveau : je me laisse happer par la facilité de lecture, et il faut que je fasse l’effort de prendre du recul pour percevoir l’intelligence du discours, la réflexion sur la nature de la société, les convictions de l’auteur. La forme joue sur le sensationnel et le spectaculaire, alors que le fond constitue une profession de foi sur ce qui fait une société.
Merci Tornado pour le pavé, je vais dire que je suis totalement d’accord avec Présence et avec ta conclusion, même si la valeur intrinsèque n’a que peu de prise sur moi (en gros : je m’en fous).
Tiens, je viens d’aller voir l’expo sur Jean-Michel Basquiat (mais en n’ayant pas vu celle sur Schiele, à mon grand dam, car il était impossible d’y entrer sans faire deux heures de queue) et la plupart des gens autour de moi ne comprennent pas, trouvent ça immature, des dessins d’enfants. Personnellement je suis incapable de défendre Basquiat mais simplement j’ai pris énormément de plaisir à voir ces (souvent) grandes toiles en vrai, je trouve ça beau.
Evidemment, je suis un peu aussi élitiste (parenthèse : toi le fan de Magma tu ne prends que de la musique facile d’accès ? ahahah), et je rejette en bloc les trucs sirupeux (la mauvaise country, André Rieux, Bon Jovi, plein de trucs de rap qu’écoute Zoé…), ça me hérisse le poil. Mais je suis fan des trucs sirupeux de Kylie Minogue aussi. Donc je dirai que c’est du goût tout court, des propensions, en aucun cas de la réflexion (ce qui rejoint mes réactions face à Basquiat).
Mais oui mais oui : J’aime le sirupeux et aussi l’art contemporain hyper opaque. J’aime Julio Iglesias et Magma, tout en sachant très bien que les deux ne se valent pas. Et d’ailleurs je ne les écoute pas du tout de la même manière 😀 (c’est rigolo que tu me parles de Magma car j’ai ces jours-ci énormément écouté le groupe sur mon I-phone).
Je visite régulièrement des expos d’art moderne ou contemporain et parfois j’y emmène mes potes. Je suis souvent exaspéré par leurs réflexions sur les oeuvres qui ne sont pas belles et pas immédiatement compréhensibles. Les boulets ! 😀
@Présence : Je me souviens qu’on a parfois discuté de cette différence entre ton ressenti et le mien : Tu aimes la densité (aussi bien en lecture qu’en musique, d’ailleurs), et moi j’aime l’épure.
Mais effectivement c’est très enrichissant de percevoir le « goût des autres » quand on s’apprécie mutuellement ! 🙂
Ta remarque me fait penser qu’il faut absolument que je propose à Bruce un article sur un strip minimaliste (sans décor ou presque) qui me fait rire à chaque fois : Dilbert, une exception qui confirme la règle en termes de densité.
Tout à coup je frémis d’impatience….
« Depuis la découverte initiale de la communauté de Woodbury (et l’accueil reçu), le lecteur avait la ferme conviction que la confrontation serait inéluctable, sous la forme d’une attaque menée par les troupes du Gouverneur. » Oui, cela était totalement évident. Et par la suite, le lecteur a pu penser saisir le rythme de la série : découverte d’une autre faction, évolution de la situation globale (la fameuse société en reconstruction), confrontation sanglante, retour à un statu quo bancal, possiblement ailleurs (exode).
« réalisé par des experts dans l’absence de nuance » AHAHAH
« haletant, lessivé » : tout à fait d’accord. Et c’est sans doute pour cela que par la suite, les lecteurs ont trouvé le temps long. Je ne pense pas qu’autant de violence et d’adrénaline ait eu lieu par la suite.
« partir en capilotade » : je ne connais pas cette expression.
J’ai beaucoup aimé ta dernière partie sur les réactions de chacun, la propension à devenir des moutons, l’incertitude de l’avenir. Mais tout comme dans LA ROUTE (que j’ai lu mais toujours pas vu), je ne pense pas que l’humanité redeviendrait sauvage à ce point, je crois au contraire que l’entraide primerait. Espérons que nous n’en soyons jamais certains…
Pour le reste ton article est à la hauteur de l’arc qu’il chronique : épique et marquant. Je ne vois pas quoi ajouter d’autre.
La BO : j’aime bien les morceaux de Carpenter pour ses films mais j’ai tout de même la sensation que c’est un peu toujours la même chose. J’aime beaucoup ce film, je l’ai en DVD chez un pote depuis au moins six ans.
Tu m’as mis le doute pour l’expression. Du coup je suis allé vérifier et je suis tombé sur cet article amusant.
https://www.mots-surannes.fr/?p=3032
Merci pour l’article, bien marrant effectivement. Je suis allé pour ma part voir la définition de capilotade : http://www.cnrtl.fr/definition/capilotade
Et ça colle parfaitement avec le sujet du jour :
« Para analogie :
1. Mise en pièces de manière à produire une impression de mélange confus, de gâchis. Nous avons demandé des cigarettes aux Allemands sur les routes d’un pays en capilotade (R. Fallet, Banlieue sud-est,1947, p. 113):
1. Penché à la portière du wagon, Durtal plongeait directement dans l’abîme (…) Seigneur! si l’on déraillait! Quelle capilotade! se disait-il. Huysmans, La Cathédrale,1898, p. 23.
2. Mise en pièces, produite par des coups et blessures. »
BO alternative : https://www.youtube.com/watch?v=lIAUkJoj3bc
😀
Note personnelle (et un peu pour Bruce aussi) : avec le collants sur le divan de Doom, j’ai fait le tour de mes articles en retard : cela m’a pris bien longtemps non ? Je ne compte pas ceux qui sont au garage et qu’il faut donc toujours que je lise :
– Immatériels 1
– Tintin en Orien
– Les personnages de Tintin
– Les monstres de la Hammer 1
– Les monstres de la Hammer 2
– Evangelion
– Jackie Chan
ni ceux que je n’ai pas lu car je compte bien lire la bd d’abord (TWD, Strangers in Paradise, Scalped, Batwoman…), ni ceux qu’il faudrait que je relise (trop nombreux mais pointons du doigt les deux artticles sur Cowboy Bebop que j’adorerai relire avec les commentaires)…
Que des articles en voie de remasterisation.
Pour Tintin, je ne peux rien faire sans le feu vert de Moulinsart. Dommage, l’anniversaire du personnage était une l’occasion idéale…
HubertPrésence, je reviens te commenter plus tard.Un article d’une ironie inhabituelle chez Présence pour un arc majeur de la série. Tu as raison sur tout : l’exagération à outrance, la mise en scène appuyée et puis de toute manière, tu es aussi tombé dans le panneau : malgré tout ça, c’est de la bonne !
Made to suffer, c’est le Ziggy Stardust de la série. L’épisode vers lequel ont culminé les 8 arcs précédents. Par la suite la série ne sera plus jamais pareille. Elle pourrait même s’arrêter ici. Au cinéma, c’est typiquement le genre de fin d’un film de Zombies.
C’est une histoire que j’adore, elle ne fait pas dans la nuance mais elle délivre un sentiment cathartique que je ne trouverai jamais dans un gros événement Marvel ; un sentiment d’authenticité et….d’enfance !
Je m’explique : Made to suffer si l’on y regarde bien reprend les codes de plein de trucs que l’on regardait enfant :
-Avec son bandeau, Le Gouverneur est clairement le vilain pirate qui vient accoster et voler le vaisseau des gentils.
-Michonne et son sabre, la décapitation du Sidekick de Rick, c’est du film de Samourai.
-Quant à l’assaut de la prison avec son rapport de force déséquilibré, comment ne pas penser à Alamo ? Étonnant d’ailleurs que Tornado ne m’ait jamais proposé l’article !
Lorsqu’on lit Invicible, on se rend compte du côté roublard de Kirkman et de cette référence Fun-culture populaire. Elle est encore là, bien cachée dans WD. Ainsi lorsque Rick est vaincu par les Pirates de Blake (!), il découvre un territoire peuplé de Cannibales !
C’est à mon avis la sève de la première saison de WD. A partir de Negan, ces références inconscientes à la culture populaire s’estompent et ce qui explique, pourquoi pas, l’impopularité de la série pour certains. On y trouve bien des personnages habillés en chevaliers, Michonne sur un vaisseau habillée en Pirate (!) mais ça ne marche pas longtemps. WD devient alors une série d’adultes pour adultes.
C’est cet esprit qui manque cruellement à la série TV que j’ai abandonnée sans regrets. Lorie s’y suicide enlevant par là-même le choc de la splash page qui me fit hurler littéralement. Rick perd sa famille, ce vers quoi il tend depuis le premier épisode. C’est la première amarre de larguée vers le changement progressif de la série.
@Tornado : Au secours ! S’il est une chose qui est insupportable c’est la théorisation du gout. Nous avons tous la notre mais lorsque c’est institué c’est mortel et tellement inefficace. Tu veux savoir ce qu’est le rire ? Tu regardes un Chaplin ou un ZAZ. Tu dégustes Le NOM DE LA ROSE. mais certainement pas le bouquin de Bergson….Mon Dieu, quelle horreur…
LA scène que j’évoque de LA LISTE DE SHINDLER est celle où Spielberg joue sur le suspense au moment où les déportés arrivent sous une douche. Il y a un temps de latence pas du meilleur goût où l’on ne sait si c’est du gaz ou de l’eau qui va en sortir….
Pour le reste je pense être bien meilleur public en cinéma qu’en Comics. J’aime beaucoup les comédies à la française…
Un sentiment d’authenticité : c’est exactement ce que j’a ressenti.
Un sentiment d’enfance – J’aime beaucoup ton développement sur l’intégration d’éléments d’autres genres romanesques. D’un point de vue pragmatique, je n’y ai vu que le retour à des forme de société moins modernes, avec le bandeau pour cacher l’œil mort (parce que la médecine est revenue à un stade rudimentaire), le katana (parce qu’on peut l’utiliser sans munition qui ne sont plus fabriquées), Fort Alamo (parce qu’on en revient à des petites communautés fortifiées). Mais d’un point de vue littéraire, c’est exactement ce que tu dis : une dimension postmoderne se nourrissant des conventions d’autres genres. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Une ironie inhabituelle – On échangeait sur les auteurs qui prennent les lecteurs pour des idiots pour un autre article : Robert Kirkman et Charlie Adlard me donnaient l’impression dans ces premiers tomes d’adopter une narration la plus explicite possible en soulignant tous les effets pour être sûrs que le lecteur ne rate pas leur intention, comme si son intelligence était à mettre en doute. Je comprends la valeur de l’émotion, du sensationnel et du spectaculaire dans un récit (comme l’a souligné Tornado), Sur moi, ce mode narratif au premier plan a pour conséquence de masquer la réflexion sur la nature humaine, sur ce qui permet à une société de fonctionner, sur les choix politiques sous-jacents. C’est ce qui a provoqué mon ironie sur le décalage des 2 niveaux de lecture.
Merci beaucoup pour cet éclairage Sans ton commentaire je n’y aurai pas autant réfléchi.
Une ironie inhabituelle – Jamais, je ne me suis senti blousé par Kirkman. Même dans THE HAUNT. Je n’aime pas grand chose de lui, mais c’est plutôt honnête comme écriture.
Quant à l’ironie, j’y vois une permutation : les bouquins que tu me files me rendent plus tolérant, les miens te rendent plus acerbe. Les livres seraient-ils porteurs des personnalités de leurs propriétaires ?
Je ne pense pas que les livres soient porteurs de la personnalité de leur propriétaire, mais ils serait malheureux que depuis le temps que les rédacteurs du site échangent leurs points de vue et les argumentent, nos opinions n’aient pas évolué.
Mis à part sur WD, sur quoi penses-tu avoir évolué Présence ; JrJr ?
Ma mémoire ne fonctionne pas comme ça, je ne pourrais donc pas te faire une liste. Il m’en vient quand même à l’esprit trois commentaires qui m’ont incité à sauter le pas : Fantastic Four the end, Grim Fandango, The other Side… deux autres recommandés par toi personnellement Ces jours qui disparaissent, L’esprit du 11 janvier. J’en oublie sûrement.
Je pense aussi que les différentes découvertes que j’ai pu faire avec les articles du sites ont contribué à ma culture, à des critères d’appréciation qui m’étaient étrangers.
Tout d’abord; tout comme Présence, bravo pour ton analyse sur les genres de récits transformés pour les adultes dans les premiers TWD. C’est très fort.
Quant aux livres qui correspondent aux caractères de leurs lecteurs, c’est une piste intéressante !
impressionnante semaine sur Walking Dead. Je lis ça et là que c’est trop long, que Kirkman noie le poisson etc…
si j’avais revendu le premier tome Semic aussitôt persuadé d’avoir acheté le comics officiel de la NRA (il faut être armé mon fils, pour pouvoir se défendre, défendre ses proches, tiens je te donne mon stetson pour que tu te sentes adulte etc… bon là j’ai vomi et j’ai revendu)
j’ai depuis emprunté divers tomes, et oui, c’est une gande saga qui n’est pas fabriquée pour avoir une fin conventionnelle. En fait on s’en bat un peu des zombis. c’est vraiment une histoire sur la reconstruction de l’humanité quand on l’a détruite. une histoire qui pourrait traverser les générations de héros un peu comme les romans historiques de James Michener (Colorado Saga), c’est le contexte qui nourrit les personnages et eux incarnent le contexte. C’est sans doute une pièce maîtresse du comics.