JE T’AIME, MOI NON PLUS de Serge Gainsbourg
Un article de LUDOVIC SANCHESJ’avais dû découvrir JE T’AIME, MOI NON PLUS lors d’une de ses rares diffusions télévisées, il faut dire que le film passait peu sur les petits écrans, il sort même en DVD en 2006 dans la bien nommée collection « Les Introuvables » chez Wild Side.
C’est lors de sa reprise en salles en 2023 dans une version restaurée 4k que je le redécouvre et décidément je trouve que c’est un très beau film. Or si Gainsbourg musicien est encore l’objet d’un culte vivace, le Gainsbourg cinéaste est souvent vu d’un œil plus circonspect, il y a encore quelques années dans les colonnes des Inrocks, Frédéric Bonnaud, actuel directeur de la Cinémathèque Française, voyait dans sa filmographie une succession « d’impossibles nanars, auxquels même le second degré ne rend pas grâce. » Il ne s’agira pas ici de réhabiliter en totalité la veine cinématographique de Gainsbourg sur lesquelles on peut avoir quelques réserves justifiées mais elle n’en reste pas moins une facette passionnante de son œuvre dont JE T’AIME, MOI NON PLUS reste le diamant noir.

© Splendor Films source: site du distributeur
Le cinéma a une place importante très tôt dans la carrière de Gainsbourg que ce soit en tant qu’acteur quand il va jouer de son physique ingrat pour camper des méchants fourbes dans des péplums italiens de seconde zone ou comme compositeur de musiques de films, des bandes originales qui seront un vrai terrain d’expérimention musicale pour lui et ses collaborateurs du moment (Alain Goraguer, Michel Colombier, Jean-Claude Vannier) et l’occasion de composer quelques uns de ses tubes (L’EAU A LA BOUCHE pour le premier film de Jacques Doniol-Valcroze, REQUIEM POUR UN CON pour LE PACHA de Georges Lautner, le thème d’ELISA étant même tiré de la musique du film L’HORIZON de Jacques Rouffio). C’est sur le tournage de SLOGAN de Pierre Grimblat en 1968 (dont il compose aussi la musique et la chanson du film) qu’il rencontre Jane Birkin. Sur les conseils de Jacques Séguéla, Gainsbourg se fait la main en tant que réalisateur en tournant des publicités pour de la lessive avec Jane.
Jacques-Éric Strauss accepte de produire son premier long métrage à condition que le titre reprenne celui de la chanson dont le succès et la réputation sulfureuse ont fait quelques années plus tôt la célébrité du couple Gainsbourg/Birkin. Avec le soutien de Claude Berri, le film sort en 1976, échappant de peu à un classement X et malgré les compliments entre autres de François Truffaut, l’accueil est mitigé et le succès commercial n’est guère au rendez vous. Dans les années 70, Gainsbourg est toujours en quête de reconnaissance, ses albums phares de l’époque ne lui valent qu’un succès d’estime, il lui faudra attendre la sortie de AUX ARMES ET CAETERA qui lui vaudra son premier Disque d’Or et lui permet de remonter sur scène. Pour son premier film, Gainsbourg fait pourtant preuve de la même radicalité que dans ses plus grands disques aujourd’hui internationalement connus et respectés. Certes, il y aussi une forme de pose et de posture dans l’aura sulfureuse dont se pare le film (après tout, la provoc était déjà depuis longtemps son fond de commerce) mais son absence de concession et son audace sont pour beaucoup dans la fascination qu’il provoque encore.

© Splendor Films source: site du distributeur
Le charme et l’originalité de JE T’AIME, MOI NON PLUS tient beaucoup à son refus absolu du naturalisme à la française au profit de la création d’un monde imaginaire: le film est tourné en septembre 1975 dans le Gard prés de Uzés sur le plateau de Lussan prés d’un aérodrome où Gainsbourg installe un décor essentiellement constitué d’une salle de bar, un snack ou plutôt d’une réplique de diner à l’américaine dans une version assez cheap tandis que ces paysages sauvages du Sud Est de la France prennent des allures de désert westernien. Au mépris de tout réalisme, Gainsbourg recrée une Amérique rêvée avec trois fois rien dans un geste évoquant celui d’un Georges Lautner qui attiré par les sirènes de la contre-culture allait fuir un temps les truands franchouillards et les bons mots de Michel Audiard pour faire en 1970 LA ROUTE DE SALINA, cet étrange drame érotique et trouble qui reconstitue une Californie fantasmée dans les décors de l’ile de Lanzarote sur une musique écrite par Christophe. Par ailleurs, JE T’AIME, MOI NON PLUS est dédié à Boris Vian qui se déguisa en écrivain de romans noirs pulp pour réinventer aussi à sa manière puis pervertir une certaine image de l’Amérique.
Dans ce coin paumé littéralement au milieu de nulle part débarquent un couple d’hommes, Padovan et Krass, au volant d’un camion convoyant des déchets. Voulant déjeuner, ils font halte dans le seul endroit ouvert dans le coin, le snack-bar de Boris, un type peu sympathique, sale et vulgaire. Boris y emploie une jeune serveuse surnommée Johnny parce qu’elle ressemble à un mec et dont le physique androgyne fascine et attire Krass. Peu à peu se crée un étrange triangle amoureux entre les deux hommes et la jeune femme, Johnny tombe amoureuse de Krass mais celui-ci a du mal à avoir des relations avec elle tandis que Padovan, voyant son amant lui échapper, devient de plus en plus jaloux et violent. L’intrigue du film ressemble aux histoires que raconte Gainsbourg dans ses chansons et ses fameux albums-concept: comme dans MELODY NELSON ou L’HOMME A LA TETE DE CHOU, la passion amoureuse entre un homme et une femme conduit inévitablement au drame (« c’était foutu d’avance » chantera-t-il dans SORRY ANGEL) et même « l’amour physique est sans issue« . Tout Gainsbourg est là, y compris ses obsessions les plus scabreuses comme sa fixette sur le sexe anal (remember LA DECADANSE) ou son gout pour la scatologie et les flatulences (comme dans son unique roman EVGUENIE SOKOLOV).

© Splendor Films source: site du distributeur
Gainsbourg ne cache pas le caractère assez anecdotique de son histoire qui aurait pu donner lieu à un huis clos dramatique vénéneux à la Tenessee Williams, mais la psychologie des personnages et le symbolisme ne l’intéresse guère, il préfère filmer des lieux, des atmosphères et des corps surtout, des images sorties de son imaginaire et de ses fantasmes, les mêmes obsessions qu’il ressasse à l’instar des structures souvent répétitives de beaucoup de ses chansons (c’est évidemment ici l’entêtante ritournelle de la BALLADE DE JOHNNY JANE qui revient du début à la fin du film). EQUATEUR, son film suivant tourné en 1983, reprendra d’ailleurs le même point de départ (un homme débarque au milieu de nulle part pour y vivre une passion amoureuse tragique), le même bar sinistre tenu par le même taulier (à nouveau interprété par le comédien allemand Reinhard Kolldehoff) avec cette fois ci un Congo rêvé en guise de toile de fond et une trame de film noir inspirée d’un roman de Simenon dont Gainsbourg ne tirera pas grand chose d’autre que quelques clichés un peu usés (une histoire de meurtre, une femme forcément fatale…).
Comme c’est le cas dans sa discographie, ce n’est pas faire insulte à Gainsbourg de rappeler qu’une partie de son talent, c’est d’avoir su bien s’entourer. Si il est bien l’auteur complet de son film, la réussite de JE T’AIME, MOI NON PLUS doit beaucoup aux images du chef opérateur Willy Kurant (qui avait collaboré avec Godard, Skolimowski et Welles et fait la lumière de ANNA, la comédie musicale avec Anna Karina dont Gainsbourg avait composé les chansons) et le travail du décorateur Théo Meurisse (qui avait fait les décors de L’ARMEE DES OMBRES et du CERCLE ROUGE de Melville et bossera plus tard avec Bertrand Blier). Un réalisme cru avec cette lumière naturelle qui vient irradier ces paysages de routes désertes, de terrains vagues et de décharges d’ordures et ce clair obscur en huis clos dans des chambres d’hôtel miteuses et sinistres dans lesquelles la caméra à l’épaule vient filmer au plus prés les corps qui s’étreignent, la silhouette fragile et diaphane de Birkin se tordant à terre en poussant des hurlements comme une créature d’une peinture de Francis Bacon.

© Splendor Films source: site du distributeur
Pendant la scène du bal, le grotesque côtoie le sordide, la grâce se mêle à la violence: sur fond d’un rock’n roll frelaté, un striptease glauque se déroule sur scène auquel succède bientôt une version slow de JE T’AIME, MOI NON PLUS sur laquelle Johnny et Krass se mettent à danser. La caméra tourne fiévreusement autour d’eux mais cette épiphanie romantique est montée en parallèle avec le violent passage à tabac de Padovan par une bande d’ordures venus se venger et casser du pédé (avec parmi eux, Michel Blanc, aussi ridicule que détestable). Le cri de douleur de Padovan venant brutalement couper la musique et annonçant les hurlements de Birkin plus tard dans le film. La beauté revêt un caractère intensément tragique et la poésie ne se révèle que quand elle côtoie la saleté, l’ordure: le film s’ouvre sur la vision d’une gigantesque décharge à ciel ouvert et c’est en pataugeant dans la fange qu’on cite du Shakespeare. Derrière l’ironie provocante, il y a ce profond romantisme, un romantisme noir et désespéré dans lequel le trivial rencontre le sublime et c’est aussi la conception de l’art de Gainsbourg, peintre frustré, se rêvant touche-à-tout de génie tout en se donnant des airs de dandy dilettante, transcendant les frontières entre arts mineurs et arts majeurs.
Pour incarner ces deux amants maudits, Gainsbourg ira chercher Joe Dallesandro, ancien modèle découvert par Andy Warhol à la fin des années 70 et immortalisé à l’écran dans les films de Paul Morrissey où il incarne une présence masculine suscitant un désir érotique magnétique autant sur les hommes que sur les femmes, faisant de lui une icone bisexuelle très en avance sur son temps. Quittant un temps les Etats Unis, Dallesandro viendra tourner en Europe pour Louis Malle et Jacques Rivette entre autres. Gainsbourg savait ce qu’il faisait en le filmant et il y a aussi une facette queer dans son œuvre (qui s’exprimera dans LOVE ON THE BEAT avec sa pochette sur laquelle il apparait travesti en femme et la chanson KISS ME HARDY), une sorte de fascination pour les amours homosexuelles teintées de marginalité et de clandestinité comme chez Jean Genet mais dans JE T’AIME, MOI NON PLUS on peut aussi admirer l’audace de montrer à l’écran en 1976 un couple homosexuel sans la moindre forme de dérision ou de moquerie. Et puis il y a Jane Birkin qui se donne corps et âme à l’écran et transcende son personnage de femme enfant et dont Gainsbourg aura su saisir la grâce, même si il la malmène.

© Splendor Films source: site du distributeur
Si JE T’AIME, MOI NON PLUS a gagné avec le temps une aura et une reconnaissance (surtout à l’étranger) qu’il n’avait pas eu à sa sortie en France, les films suivants de Gainsbourg sont plus difficiles à revoir et à aborder. EQUATEUR, qui sera très mal accueilli lors de sa sélection à Cannes, souffre de certaines pesanteurs. CHARLOTTE FOR EVER apparait étouffé par ses parti pris formels de huis clos claustrophobe à la mise en scène surstylisée et aux images ultra-composées. Les ambitions esthétiques de Gainsbourg s’abiment dans un visuel aujourd’hui daté qui étouffe sa volonté de filmer son amour pour Charlotte dont la beauté fragile et le naturel désarmant ne trouve pas ici un écrin à sa mesure. Même quand il ose aller au bout de son fantasme en la filmant en train de danser, il frôle le maniérisme clinquant et rappelle ce qu’il peut y avoir de maladroitement publicitaire dans son imaginaire visuel. Reste que c’est peut-être son film le plus radical et il a quelque chose de troublant dans son impudeur, Gainsbourg ayant même reconstitué en studio le décor de sa maison du 5 rue de Verneuil. STAN THE FLASHER, le dernier, a du mal à creuser de manière convaincante les obsessions de son auteur (affres de la création, exhibitionnisme et fantasmes nabokoviens) malgré la présence touchante de Claude Berri.
Il me semble pourtant clair qu’il n’y jamais eu d’opportunisme dans la démarche de Gainsbourg de s’essayer au cinéma, il l’a fait avec sincérité, croyant vraiment trouver un moyen d’y exprimer sa personnalité, sans transiger ni essayer de donner le change, sans vouloir plaire à tout prix ni flatter le spectateur.
La BO du jour:
The Raveonettes – Love In A Trashcan
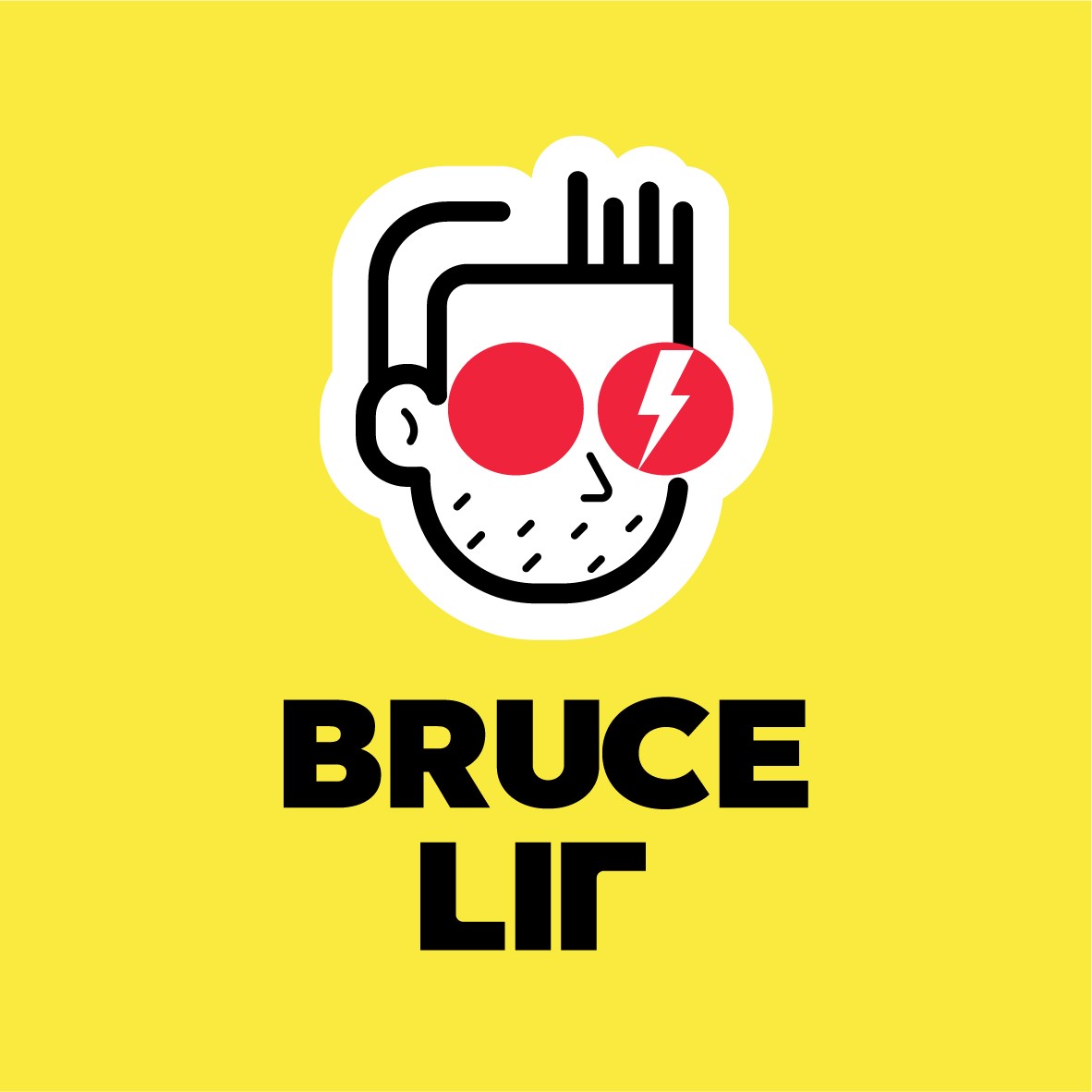
Tout fan ABSOLU que je sois de Serge Gainsbourg, je n’arrive pas à entrer dans ses films (tous vus sauf ÉQUATEUR). Je reconnais leurs étonnantes qualités artistiques (notamment celui-ci), mais je suis vraiment resté en dehors du début à la fin. Les histoires qu’il raconte, déjà, systématiquement concentrées sur le rapport entre l’homme et sa condition de viande sur pattes, me font fuir (alors qu’en chanson, c’est beaucoup plus métaphorique, plus diffus, plus classe, plus séduisant). Et leur mise en forme crue (crue de chez crue) encore plus.
Si sa musique n’a aucun mal à m’envoûter, en général, son cinéma me fait l’effet inverse : Il me révulse. Je lui trouve un arrière-goût beaucoup plus proche de la musique punk que de son style habituel. Ses films sont sordides, ils sentent mauvais la pisse, suintent le glauque par tous leurs pores. Du punk, en somme.
Mais c’est bien qu’ils existent.
J’avais lu le découpage technique du film. Serge avait une aisance bluffante dans la connaissance de la mise en scène. Ses notes témoignent d’une vision extrêmement professionnelle, cochant toutes les cases de la maitrise du vocabulaire cinématographique, et leur ajoutant une plus-value artistique pleine de sensibilité. Dommage, encore une fois, que cette sensibilité côtoie constamment la fascination pour le réalisme sordide glauque. Ce n’est pas du tout ma cinéphilie, hélas.
La BO : J’aime beaucoup. Gros travail sur les harmonies, notamment au chant (c’est parfois lynchéen selon les chansons). Le genre de groupe postmoderne que j’affectionne (malgré sa batterie souvent assomante). Serge aurait sûrement aimé.
Je comprends ton ressenti Tornado et en même temps c’est intéressant ce que tu dis parce que tu notes bien a quel point Gainsbourg a eu une approche très consciente de la mise en scène et l’esprit « punk » de ce film, c’est aussi ce que le sauve au sens ou l’on voit bien comment l’approche artistique de Gainsbourg (qui s’explique quand on connait un peu l’œuvre du bonhomme) aurait pu aller vers ce professionalisme, cet académisme de l’image bien faite, piège dans lequel les films suivants tombent en partie malheureusement. La rugosité et l’âpreté de JE T’AIME MOI NON PLUS font vraiment toute sa beauté, même si elles est sale et fragile.
Oui, c’est tout à fait ça.
Je dirais moins punk que la factory de Warhol et son lot de paumés. La présence de Dallessandro est là pour l’attester. Gainsbourg, mine de rien à côtoyé toute la clique de Warhol : lui, Nico, Marianne Faithful.
Je n’ai jamais vu ce film donc merci pour la présentation, cette très belle analyse et toutes les références bienvenues sur les acteurs (dans le sens large) de cette oeuvre, Ludovic. Dans les années 80 je me souviens que Gainsbourg avait réalisé un film publicitaire pour France Télécom (je ne sais plus si ils s’appelaient déjà comme ça à l’époque, maintenant c’est juste Orange) lorsque les numéros de téléphone passèrent de 8 à 10 chiffres si je me souviens bien (c’est flou). Le reste, jamais vu, ni même lu son roman.
J’ai vu une dizaine de Truffaut pendant le confinement (en gros, ce devait être en 2021 en fait) et je peux dire que je déteste. J’ai bien aimé LES 400 COUPS (son premier) et surtout son tout dernier, VIVEMENT DIMANCHE. Sinon son statut de grand réalisateur est pour moi un réel mystère tant tout m’horripile dans ses films. Même JULES ET JIM m’a gavé (mais il y a trois quatre belles séquences).
Ces faux Etats-Unis fantasmés, on les trouve dans d’autres films français, comme CANICULE si je me souviens bien, ou L’ETE EN PENTE DOUCE, et bien sûr TOTAL WESTERN de Eric Rochant avec Samuel Le Bihan. Mais je suis certain qu’il doit y en avoir d’autres.
Je ne chercherais pas à voir les films de Gainsbourg (et la bande annonce que tu as mise ne donne pas envie) mais si je tombe dessus, je penserai pour sûr à ton article, Ludovic. Merci beaucoup.
La BO : jamais trop écouté ce groupe, sympa.
« Je n’ai jamais vu ce film donc merci pour la présentation, cette très belle analyse et toutes les références bienvenues sur les acteurs (dans le sens large) de cette oeuvre, Ludovic. »
Voilà. Tout pareil.
Jamais intéressé, ni par ce film ni par les autres films de Gainsbourg.
Tellement de films à voir et à revoir que ça m’étonnerait que je le regarde un jour.
Ceci dit, même si ce n’est pas le sujet ici, je m’inscris en faux et je rebondis sur Truffaut qui est un cinéaste qui me touche très souvent beaucoup.
Son approche de l’enfance, son goût du romanesque, son cinéma souvent à fleur de peau et fiévreux dans lequel on sent qu’il met tant de lui-même m’a toujours beaucoup interpellé.
Et puis, Les deux Anglaises et le continent, c’est un pur chef d’oeuvre. Un des plus beaux films du cinéma français, avec un Jean-Pierre Léaud extraordinaire.
La BO : super morceau. Mais j’aurais choisi le fabuleux Dirt des Stooges.
Pas eu le courage de me fader Les deux anglaises et le continent. De ce que j’ai vu, Truffaut ne réalise pas, il met en scène, et son romanesque ne me touche pas du tout (j’ai cru que ça allait passer puisque les 40 premières minutes de LE DERNIER METRO sont pas mal et en fait après ça c’est horrible), le plus flagrant pour moi étant LA FEMME D’A CÔTE où je ne crois en rien. J’ai détesté les Doinel (sauf le premier donc) où Léaud joue parfois bien parfois comme une patate, où les personnages me semblent plus pathétiques qu’attachants, où j’ai pu avoir deux ou trois sourires sur la totalité de ces films (c’est bien trop peu), FAREINHEIT 451 fut un supplice, TIREZ SUR LE PIANISTE aurait pu avoir ma sympathie pour les chansons et la tronche de Boby Lapointe et Michèle Mercier dénudée mais je me suis ennuyé, rien ne me touche chez lui. J’ai un bon souvenir de L’HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES et de LA MARIEE ETAIT EN NOIR mais il faudrait que je les revoie – et je ne suis pas du tout motivé.
La fin de carrière de Truffaut, je ne la trouve pas très passionnante.
Le dernier Doinel n’est pas bon, Le dernier métro et La femme d’à côté sont aussi des films que je n’aime pas beaucoup.
Et Léaud ne joue jamais comme une patate. Il échappe à toute catégorisation. Léaud joue comme Léaud. C’est à prendre ou à laisser. Radicalement. Et c’est comme ça que c’est conçu.
Après, que ses films ne te touchent pas, c’est comme ça, je ne peux évidemment rien y faire mais ce qui est marrant, c’est que mes Truffaut préférés ne figurent pas parmi tous ceux que tu as cités. 🙂
« Mais qu’est-ce que j’ai? J’ai l’air vieux aujourd’hui. »
Final bouleversant dans le jardin du musée Rodin avec la sublime musique de Georges Delerue.
Un peu comme Zen Arcade, j’aime beaucoup Truffaut, c’est un cinéaste qui a beaucoup compté pendant mes années de lycée ou j’ai découvert la plupart de ses films avec passion, LA NUIT AMÉRICAINE, JULES ET JIM, TIREZ SUR LE PIANISTE, LA FEMME D’A COTE que j’aime beaucoup et évidemment LES 400 COUPS qui reste un de mes films préférés et dont je me lasse pas. Il y a en effet plein de choses qui me touchent dans ses films tout en reconnaissant les réserves qu’on puisse avoir sur son œuvre et le caractère inégal de sa filmo. Mais ses films et le personnage et ce qu’il m’a fait découvrir de tout un pan de l’histoire du cinéma a été trop important pour que j’oublie ses films.
LA FEMME D’A CÔTE est l’une des plus belles histoires d’amour du cinéma pour moi.
F 451 est intiment lié à Gainsbourg, puisque c’est Andrew Birkin qui en assure la superbe photographie.
Et L’ENFANT SAUVAGE est un super moyen de réviser son bac philo sans trop se fouler.
J’ai un peu de mal avec Depardieu chez Truffaut.
Ca m’a toujours donné l’impression de deux univers qui ne collaient pas ensemble.
L’enfant suavage, j’aime beaucoup, par contre.
Je trouve au contraire que c’est chez lui qu’il peut exprimer pour la première fois sa sensibilité à l’écran.
D’ailleurs Depardieu apparaît dans le film de gainsbourg.
Quelle évidence : pour faire plaisir au Boss et caser des références à Gainsbourg dans un article, tu as choisi de chroniquer une de ses œuvres. Bravo ! 😉
Les lignes sont tellement marquées par une certaine déférence à l’égard de Gainsbourg que j’ai cru qu’elles étaient signées de Bruce ! (ça m’apprendra à être dans le pâté et ne pas lire le nom de l’auteur en début d’article…)
Tu en parles avec emphase mais le sujet ne m’intéresse aucunement. Bizarrement, l’acteur et son look en marcel m’a évoqué furtivement celui de Flash Gordon…
Ah ah ! bon je suis un Gainsbourgien depuis mon adolescence ou je m’étais plongé dans sa discographie en empruntant à la médiathèque la collection de CD « TOUT GAINSBOURG ». Ca remonte donc pas mal et j’ai pas eu trop à me forcer pour écrire cet article, en tous cas quand il s’agit de déclarer mon affection pour son œuvre.
Mais quel décorticage élaboré ! Chapeau.
Ça remonte à loin, ce visionnage…
Oui : la banalité objective avec laquelle le couple des deux mecs est présenté donne d’emblée un abord « naturel » à l’ambiance du film, même si, comme dit dans l’article, il y a une énorme part d’imaginaire dans le rendu du reste : Gainsbourg s’intéresse surtout aux interactions des personnages (…), et ne se prend pas trop la tête pour étoffer le contexte.
Bon, j’ai vu ce film étant jeune et, beaucoup plus concerné par l’utilisation de l’argument Homosexuel, la « romance » Johnny/Krass ne m’a paru à aucun moment crédible -en tous cas, pas de son point de vue à lui. Bizarrement, alors que cette anomalie (à mes yeux) annihile l’intérêt de la démonstration, tout le décorum « traditionnellement » rattaché à une certaine vision médiatique (70’s/80’S) de la scène Homo Américaine est bel et bien présent : les sensations un peu crades exprimées plus haut par Tornado. 😉
Il y avait là trop de l’approche intellectuelle typique de cet artiste, que j’ai toujours trouvé un peu perdu dans le style, au détriment du sujet -dans ses chansons, s’entend (mais je ne suis pas un grand amateur, donc loin d’être un spécialiste).
… Je ne me souviens de rien d’érotique ?! La faute au côté lisse (archi-lisse, même !) de Dallesandro, probablement. Peut-être la benne à ordures -et encore. Et, si je n’en possède plus aucune image (ça devient grave !), je reste persuadé que je suis resté jusqu’au bout quasi seulement à cause de Jane.
Gainsbourg, paix à son âme, a décidément été infiniment plus authentique dans sa vie que dans ses œuvres, je trouve ; et ses frustrations créatives ont bel et bien défini l’homme. Je suis sûr qu’il était facile à aimer.
Ah Bruno c’est intéressant ce que tu dis: effectivement, le film n’est pas érotique du tout mais je crois aussi que ça n’intéresse pas beaucoup Gainsbourg. On connait d’ailleurs l’anecdote: il avait refusé de faire la musique du EMMANUELLE de Just Jaeckin (qui était pourtant un ami à lui) et voyait d’un œil circonspect ces histoires de batifolages et ces jolies femmes dans des décors de carte postale. C’était pas son truc et visiblement, aussi surprenant soit-il, il avait son côté pudibond.
Après, je ne sais pas si comme toi je vois une dimension intellectuelle dans son travail, moi j’y vois une vraie sincérité, il se met quand même vraiment à nu dans ses œuvres, quoi qu’il en coute…
C’est Bachelet qui fera la musique d’Emmanuelle.
Gainsbourg s’en mordra les doigts et signera le score de GOODBYE EMMANUELLE.
Je n’ai pas voulu dire qu’il n’était pas sincère -on est tous d’accord pour reconnaitre qu’il était aussi direct et spontané qu’il est possible de l’être, dans ses affections comme ses dégoûts- ; juste que son amour-réflexe de l’harmonie (musicale, verbale, visuelle et j’en passe…) prime souvent dans ses œuvres -en tous cas celles que j’ai connues. Tout le côté écorché vif, à fleur de peau et en réaction est authentique. Je suis beaucoup moins sûr de la réalité viscérale de son côté provocation : c’était en partie beaucoup le personnage ; et il n’y a probablement pas pris plus de plaisir que ça. L’empathie limite la joie qu’on peut éprouver à mettre les autres mal à l’aise ; et empathe, il l’était forcément, ayant eu la vie qu’il a eu et, surtout, ayant décidé de la mener à sa manière dès qu’il l’a pu. Ses limites artistiques sont celles de son époque, de son milieu, de sa culture : fatalement, elles nous apparaissent plus criantes avec le recul confortable de l’âge (c’est évidemment vrai pour tous les créateurs et/ou grands hommes) ; mais, dans son cas, je pense que l’homme était plus exceptionnel que son art.
Merci pour cette présentation de ce film et plus généralement d’un pan de l’oeuvre de Gainsbourg que je ne connais absolument pas.
Je dois avouer que c’est un style de cinéma qui ne m’attire pas du tout, mais j’admire le traitement des genres et de la sexualité assez osé pour l’époque, puisque c’est du rapport hétéro que vient (semble-t-il ?) le déséquilibre et le drame.
Oui, cela s’explique peut-être que Gainsbourg regardait aussi beaucoup du côté de la culture anglo-saxonne tant au niveau de la musique que du cinéma (il revendique la dimension « underground » et en ce sens regarde du côté de Wahrol, Anger etc…) et du coup, on sait que les thèmes de l’ambiguïté sexuelle et les représentations queer étaient plus présentes dans cette culture là que dans le cinéma français de l’époque par exemple (à part quelques très rares exceptions comme LA MEILLEURE FACON DE MARCHER de Claude Miller par exemple qui aborde ces thémes là un peu par la bande…) .
Hello Ludovic et merci pour ce bel article sur un film que je confesse ne pas avoir vu. On y retrouve si je comprends bien la radicalité artistique de Gainsbourg qui j’ai l’impression a toujours été meurtri de n’être que chanteur et qui posait d’autres formes d’art comme étant supérieures, ce qui fait écho à cette dispute célèbre avec Guy Béart sur le plateau de Pivot. Je suis surpris que ce film ait suscité l’engouement de Truffaut. J’aime beaucoup le cinéma de Truffaut et je le vois généralement comme un peintre du sensible. J’imagine que Truffaut a dû voir dans Je t’aime moi non plus une version moderne et soixante-huitarde de Jules et Jim avec ce trio infernal entre romantisme et douleur. Du coup ça me rend curieux et je vais le mettre sur ma liste. Fait intéressant et promo toute honte bue pour mon précédent article du blog : Joe Dallessandro a joué deux personnages différents dans les saisons 1 et 3 de Miami Vice.
Truffaut aimait le cinéma révolté et JE T’AIME MOI NON PLUS avait tout pour lui plaire.
Merci Sebastien, oui c’est vrai tu fais bien de souligner le lien entre JE T »AIME MOI NON PLUS et JULES ET JIM. Et puis Truffaut mettait beaucoup de lui dans ses films et il a du sentir cela aussi dans le cinéma de Gainsbourg.
En effet, après son escapade européenne, Dallesandro retourne aux US et à part son role dans le COTTON CLUB de Coppola, je n’avais pas réalisé à quel point il fait essentiellement des roles dans des séries télé dans les années 80. Il est apparu dans le BABYLON de Damien Chazelle mais je m’étonne qu’il n’ait pas eu droit à un vrai come back ou en tous cas que son statut d’icone d’une époque ne soit pas plus sollicité comme c’est le cas pour des acteurs un peu singuliers des années 70 comme Udo Kier ou Helmut Berger.
Mazette quel article et quelle analyse !!! Total respect.
Je n’ai pas vu ce film et je ne suis pas un fan de Gainsbourg, ce qui ne m’empêche pas d’apprécier sa musique. Et pourtant je n’ai pas pu décrocher de cet article.
Le film sort en 1976, échappant de peu à un classement X : avec le recul des décennies passées, est-il si sulfureux que ça ?
Le charme et l’originalité de JE T’AIME, MOI NON PLUS tient beaucoup à son refus absolu du naturalisme à la française au profit de la création d’un monde imaginaire: j’ai beaucoup aimé comment tu relis cette approche à son écriture musicale.
C’est en pataugeant dans la fange qu’on cite du Shakespeare… un profond romantisme, un romantisme noir et désespéré : une exacerbation des sentiments pour mieux les ressentir ?
Belle conclusion qui explicite la nature de la démarche artistique.
Merci Presence !
Sur la question du classement X, je crois qu’aujourd’hui le film reste interdit au moins de 16 ans (ce qui ne veux pas dire grand chose mais ca explique aussi qu’il n’ait jamais été régulièrement diffusé à la télé) et je dirais que oui quand même, le film reste quand même assez audacieux et sulfureux par rapport à nos critères actuels, il y a une crudité, une rudesse, un côté brut dont on trouve difficilement l’équivalent de nos jours.
Merci Ludo.
JTMNP est une histoire d’amour impossible et sans issue qui me brise le coeur. Je me reconnais beaucoup dans ce bonheur en fuite et les angoisses de Gainsbourg.
Ton article lui rend justice et j’apprends ici que nos proses seraient confondables.
Deux petits points qui manquent à mon sens à ton article : tu ne parles de la composition de Jane que sur deux lignes. Oui, elle donne tout, absolument tout son être dans ce film. Elle s’humilie à en hurler : JE SUIS GARCON pour ne pas rester dans ce trou paumé.
Allez, je vais faire ma littérature comparée : cette Jane désespérée en quête de l’amour fou, prête à tout pour s’envoler ressemble un peu à notre Pearl non ?
Et puis je boude : LA BALLADE DE JOHNNY JANE est la plus belle chanson du répertoire de Gainsbourg. Elle DEVAIT figurer en BO.
Merci Bruce ! oui peut être que toi comme moi on est bouleversés par ces personnages qui sont désespérément en quête d’amour inconditionnel et aussi quand ce sont des personnages féminins.
Sur la BALLADE DE JOHNNY JANE, je suis d’accord c’est sublime mais c’était presque trop évident, non ? Par ailleurs c’était vraiment l’occasion de caser ce groupe que j’aime vraiment beaucoup.