UNDER THE SILVER LAKE de David Robert Mitchell
Un article de LUDOVIC SANCHESCet article est la suite de LA HANTISE DU SPECTATEUR consacré à IT FOLLOWS et s’intéresse au film suivant de David Robert Mitchell, UNDER THE SILVER LAKE sorti en salles en 2018.
Comme l’article précédent, il s’agit ici d’analyser le film qui s’y prête tout particulièrement, mais il reste que celui-ci gagne à être vu en sachant le moins possible de quoi il en retourne, vous êtes avertis que les lignes qui suivent contiennent de nombreux spoilers.

Quand nous découvrons au début du film le héros, Sam (Andrew Garfield) sur le balcon de sa petite piaule de Los Angeles regarder oisivement sa voisine d’en face en train de nourrir ses oiseaux, on peut par exemple penser au PRIVÉ (THE LONG GOODBYE, 1973) de Robert Altman et au personnage de Philip Marlowe qui croisait une bande de filles hippies vivant en face de chez lui, incarnation de la jeune génération et de la contre-culture de la fin des années 60, sauf que la voisine hippie de Sam a trente ans de plus et parait drôlement anachronique dans l’univers du film. Les temps ont changé. On se dit surtout que UNDER THE SILVER LAKE semble reprendre les choses là où IT FOLLOWS les avaient laissées. On avait vu que IT FOLLOWS, dans un logique très hitchcockienne, faisait du regard du personnage et de celui du spectateur le moteur du récit. Sam commence le film, assis chez lui en train d’espionner ce qui se passe chez ses voisins et dans la cour de son immeuble à la manière de Jeffries (James Stewart) dans FENÊTRE SUR COUR (1954). La mise en scène épouse son regard.
Un jour, Sam constate qu’une jeune femme, Sarah (Riley Keough), semble vivre dans la même résidence, en colocation avec deux amies a elle. Ils finissent par se rencontrer et passent une partie de la soirée ensemble. Elle est sympathique, drôle, candide et évidemment très séduisante. Le lendemain, quand Sam retourne chez elle, elle a disparu, elle et ses amies et l’appartement semble avoir été vidé. Autant par attirance pour elle que parce qu’au fond il n’a pas grand chose d’autre à faire de sa vie, Sam va se lancer à sa recherche. Errant dans les rues de Los Angeles à la recherche d’une femme disparue, il devient désormais une sorte de Scottie (toujours James Stewart) comme dans VERTIGO (1958), la bande originale orchestrale aux accents à la Bernard Herrmann soulignant cette réminiscence. Si en apparence, ces références semblent ancrer le film de David Robert Mitchell dans le genre du « film noir », nous verrons qu’UNDER THE SILVER LAKE s’avère plus tordu dans sa manière de se couler dans un genre précis que les deux longs métrages précédents du cinéaste.

Il faut dire que si THE MYTH OF THE AMERICAN SLEEPOVER et IT FOLLOWS se caractérisaient par des intrigues somme toute assez simples et une narration parfaitement linéaire, UNDER THE SILVER LAKE déploie un récit autrement plus complexe, sinueux, plein d’impasses et de chausse-trappes, affichant d’emblée comme nous venons de le voir un grand nombre de références, tissant tout un réseaux de signes et de motifs qui ne cessent de se faire écho d’une scéne à l’autre, refusant au spectateur un premier degré de lecture univoque et assumant de ne pas répondre à toutes les question posées, tandis que la tonalité du film s’avère déroutante et imprévisible, tour à tour étrange et décalée, délirante et bouffonne, à tel point qu’on se demande parfois si on doit prendre tout cela au sérieux. Ca tombe bien: le film ne se prend pas au serieux non plus, bourré d’humour, flirtant souvent avec la comédie, il teinte le maniérisme pourtant extrêmement élégant, raffiné et même parfois virtuose qui caractérisait le cinéma de David Robert Mitchell d’une désinvolture bienvenue et rafraichissante.
Cela révèle surtout la dimension formidablement ludique du film, car si la dramaturgie du polar et de l’enquête se prête déjà idéalement au jeu de pistes, on voit comment la banalité apparente du point de départ (chercher la fille) est un prétexte à ouvrir une boite de Pandore remplie à ras bord de récits, d’histoires et de fictions potentielles que l’intrigue va faire proliférer à coups de mise en abymes et de digressions. Là où dans IT FOLLOWS, l’image peu à peu envahie par le Mal dictait une mise en scène qui forçait le spectateur à scruter les plans pour anticiper la menace, c’est dans UNDER THE SILVER LAKE le récit même qui fait se multiplier les signes, les codes, les symboles qui saturent l’espace de manière délirante. Là où le Mal s’avançait masqué et insidieusement dans IT FOLLOWS, la menace s’annonce désormais de manière tapageuse et ostentatoire: d’abord l’étrange inscription BEWARE THE DOG KILLER qui orne le mur d’un coffee shop lors de la scène d’ouverture, puis tandis que Sam rentre à pied chez lui, un écureuil mort tombe littéralement du ciel devant lui et enfin un mot sur sa porte d’entrée le menace d’expulsion si il ne paye pas son loyer.

Nous découvrirons surtout assez vite que l’univers de Sam est déjà saturé d’images et de représentations: les posters d’affiche de films sur les murs de son appartement (FENÊTRE SUR COUR comme par hasard, PSYCHOSE, L’ÉTRANGE CRÉATURE DU LAC NOIR de Jack Arnold, DEUX NIGAUDS CONTRE FRANKENSTEIN et bien d’autres) qui soulignent sa cinéphilie, des fétiches de la culture geek qui envahissent son espace et lui collent à la peau (le numéro d’AMAZING SPIDER MAN, le 144 visiblement, écrit par Gerry Conway, dessins de Ross Andru, qui reste dans sa main, le gag étant d’autant plus drôle qu’il s’agit d’Andrew Garfield qui a, faut-il le rappeler, lui même joué le rôle de Spidey au cinéma); même quand il couche avec son plan cul du moment, une actrice de seconde zone, leur attention est détournée par des images, le poster dédicacé de Kurt Cobain au dessus du lit, les news en direct à la télé mentionnant la disparition mystérieuse d’un célèbre milliardaire et producteur de cinéma.
Car en plus de cela, Sam vit à Los Angeles dans l’East Side et donc pas loin d’Hollywood, l’usine à rêves, autant dire une ville tellement hantée par les images et ses icones (la tombe d’Alfred Hitchcock, le buste de James Dean en face de l’observatoire), s’offrant idéalement comme un réservoir de mythes et de fictions, ce que Jean Baudrillard écrivait dans AMERIQUE (Ed. Grasset, 1986) : « Ce n’est pas le moindre des charmes de l’Amérique qu’en dehors même des salles de cinéma, tout le pays est cinématographique. (…) La ville américaine semble elle aussi issue vivante du cinéma. Il ne faut donc pas aller de la ville à l’écran, mais de l’écran à la ville pour en saisir le secret. »

Car il se peut aussi que les apparences soient trompeuses, c’est même l’essence du genre du « film noir » et Scottie dans VERTIGO en faisait les frais, s’apercevant trop tard que la femme aimée après qui il courait n’était qu’une chimère, en fait une pure image; pour Sam, ca devient littéral, une fois disparue, Sarah n’est plus qu’une image et d’ailleurs il ne la reverra une dernière fois qu’à travers un écran.
Même quand il la revoit en rêve se baignant dans la piscine dans la cour de son immeuble, elle s’incarne de manière iconique en parodiant Marilyn Monroe dans une célèbre scène de son ultime film inachevé, SOMETHING’S GOT TO GIVE (qui devait être réalisé par George Cukor en 1962) dont le tournage sera définitivement interrompu par son tragique décès. Libre au spectateur de décoder (ou pas) ces références, David Robert Mitchell poussant extrêmement loin le jeu avec le spectateur, pour en faire un complice dans le déroulement du film: un des exemples les plus amusants, c’est quand Sam assiste à la projection en public et en plein air d’un film, ce film, c’est en fait le premier long métrage de David Robert Mitchell, THE MYTH OF THE AMERICAN SLEEPOVER. Cela pourrait juste être une auto-citation du cinéaste, mais si on regarde bien, on remarque que l’extrait que nous voyons ne correspond pas au film d’origine, un personnage féminin y apparait (joué par l’actrice Sydney Sweeney) qui n’était pas dans le film originellement. Dans une forme de mise en abyme au second degré, Mitchell joue la carte du clin d’œil pour aussitôt nous dire qu’il ne faut pas s’y fier.

A cette profusion des images et des représentations répond une multiplicité des récits: dans une librairie, Sam découvre un comic book s’intéressant aux légendes urbaines et notamment celles du fameux DOG KILLER, le tueur de chien donc. Son histoire nous est présentée sous la forme d’un film dans le film (réalisé en animation) et elle est connectée à l’histoire de la ville, le tueur ayant été possiblement inspiré par un acteur raté du temps du cinéma muet ayant immortalisé son suicide sur pellicule et incitant à tuer tous les chiens de Los Angeles. Le passé de la ville se confond avec la fiction, le quartier de Silver Lake étant construit autour du réservoir, le fameux « lac argenté », conçu sous la direction d’un certain William Mulholland (qui donne à son nom à la rue Mulholland Dr. et donc son titre au film de David Lynch), ingénieur ayant joué un rôle essentiel dans un des épisodes importants de l’expansion de Los Angeles, la construction de l’aqueduc et l’acheminement de l’eau dans la ville, épisode qui servait de toile de fond à un grand classique du film noir, CHINATOWN de Roman Polanski (1974) et aussi à QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT de Robert Zemeckis (1988). Le Silver Lake devient donc un symbole de la ville, c’est toute une histoire qui est enfouie sous ces litres d’eau et autant de sombres secrets qui se dissimulent sous sa surface.
Cela induit alors un certain rapport aux images qui prive le spectateur d’une forme d’innocence face à celles-ci: le réel ne s’offre plus à travers un mode de représentation (fut-il fictionnel), ces films ont désormais « le cinéma pour toile de fond » pour reprendre la formule de Serge Daney, nous avons affaire à une image dont le sens caché est là pour être décodé, décrypté, interprété. C’est ce qu’explique très bien Pacôme Thiellement dans un de ces TROIS ESSAIS SUR TWIN PEAKS (P.U.F, 2018), LA MAIN GAUCHE DE DAVID LYNCH, en remontant jusqu’au poète Dante Alighieri qui considérait qu’une œuvre profane se prêtait aussi à une lectio divina, celle de l’exégèse des textes sacrés : « Lire un texte sacré, c’est déjà l’interpréter. (…) Transposée dans la poétique de Dante, la lectio divina fait de chaque poème, de chaque prose, de chaque œuvre d’art un objet à la signification potentiellement infinie et dont la lecture doit se faire la plus profonde possible pour que, à l’arrivée, l’auteur et le lecteur ne soit plus que les deux faces d’un même miroir. » Et dans notre monde où la culture savante s’est vue submergée par la culture populaire, la culture geek peut en être vue comme un lointain écho: le geek, c’est celui qui refuse un rapport passif aux objets et se les réapproprie, d’où l’importance fondamentale de l’interactivité dans le processus créatif: les arts ludiques, les jeux vidéos, les easter eggs, la fan fiction, les fan theories etc…

© A24/Le Pacte
Sam baigne dans une culture populaire qui invite son consommateur à chercher ces signes : qu’il s’agisse de passer un disque vinyle de musique pop à l’envers pour y entendre des messages cryptés (qui ne sont plus sataniques comme à la grande époque, puisque dans le film le groupe vedette dont on entend les chansons partout s’appelle JESUS & THE BRIDES OF DRACULA !) ou qu’il s’agisse de trouver des significations cachées dans les films (souvenez vous du documentaire réalisé par Rodney Ascher en 2012, ROOM 237, qui analysait le SHINING de Stanley Kubrick, le moindre petit détail du film pouvant être prétexte à un délire interprétatif infini).
C’est surtout que Sam va montrer trés vite quelques prédispositions psychologiques à cet état d’esprit: souvent instable, parfois même violent, il a aussi des tendances paranoïaques et un fort sentiment de persécution. Obsessionnel au point de pouvoir voir un sens caché dans le comportement anodin d’une animatrice de jeu télévisé, il trouve son double obscur dans le personnage du dessinateur de comics qu’il finit par rencontrer et qui incarne le versant névrotique contemporain de cette tendance: la théorie du complot. Dans une société qui nous bombarde constamment de symboles et de stimulations visuelles (les sous entendus sexuels dans les pubs pour les fast-food et le tabac), les objets véhiculent des messages, en fait deviennent des mythes au sens de Roland Barthes, c’est à dire de la parole, de la doxa qui est en fait toujours celle de l’idéologie dominante, qu’on accepte tous sans se poser de question. Si on se met alors à croire que certains de ces messages servent aux dominants à communiquer entre eux (« c’est aussi commun que les nichons et les burgers » dit le dessinateur dans le film), on verse en plein dans le délire complotiste.

La prégnance des médias de masse, le caractère intrusif des nouvelles technologies crée un monde opaque ou tout est visible et paradoxalement tout semble caché: « I can see clearly now » dit le panneau publicitaire à Sam (qui lui en fait y voit surtout le visage de son ex petite amie, mais ça le spectateur ne le saura que bien plus tard). Son meilleur pote lui dit « Qui n’est pas suivi de nos jours ? » (It follows donc…) tout en s’adonnant à du voyeurisme en espionnant une jeune femme grâce à un drone télécommandé : l’issue de cette scène est troublante puisque le fantasme pervers et intrusif se voit renvoyer une image de tristesse et de solitude. Sam lui confie alors avoir le sentiment de ne pas vivre sa vraie vie mais une mauvaise version de celle-ci. Ce monde matériel et illusoire apparait comme une prison, un monde mauvais conçu par un démiurge et c’est bien un avatar de ce démiurge que Sam va rencontrer dans une des scènes clés, une des plus brillantes du film: celle du compositeur du groupe pop JESUS & THE BRIDES OF DRACULA, qui avoue à Sam composer ces chansons pour véhiculer les messages qu’on lui demande de faire passer. « Je ne fais pas attention au message, je me contente de le faire circuler » lui dit-il.
Cauchemar absolu puisque Sam va comprendre alors que le compositeur a aussi bien écrit SMELLS LIKE TEEN SPIRIT de Nirvana ou I LOVE ROCK AND ROLL de Joan Jett ou encore WHERE IS MY MIND des Pixies ou même LA BAMBA: « Ton art, ta culture ne servent qu’à nourrir les ambitions d’autres personnes, des ambitions qui vont au delà de ce que tu n’arriveras jamais à comprendre. » Toute rébellion est illusoire puisque celle-ci n’est que le produit d’un système qui conspire à entretenir cette illusion. Dans un geste de révolte et de colère, Sam tue le compositeur, le Créateur, c’est bien Dieu le père qu’il liquide ici (après tout, n’avait-il pas passé toute une partie du film à chercher Jésus !) mais ironiquement il devient lui-même un cliché de la rébellion en détruisant la guitare de Kurt Cobain comme le faisait son idole.
Dans un ultime coup de force scénaristique, l’intrigue va réaliser le fantasme de Sam : il y avait bien un mystère que Sam va percer dans une séquence particulièrement jouissive et cathartique aussi bien pour lui que nous spectateur. C’est aussi le triomphe de la fiction, oui, il y avait bien un sens caché qui reliait une chanson pop, le jeu Zelda et une carte cadeau dans un paquet de céréales ! Si cette ultime révélation permettra à Sam de retrouver enfin Sarah et de lui parler une dernière fois (à travers un écran encore une fois), elle parait bien dérisoire et décevante au regard du labyrinthe tortueux déployé par le film mais aussi du trajet de Sam: tels les personnages d’IT FOLLOWS, Sam aura surtout traversé le miroir, découvrant aussi la face cachée de Los Angeles comme la ville de Detroit en avait une. Au pouvoir occulte, aux classes dominantes, aux médias tentaculaires répondent une communauté de marginaux, d’exclus, de déclassés (les hobos, les clodos) qui ont leurs propres codes, tout un bestiaire aussi (les chiens, les chouettes, les putois, les coyotes) qui eux voyent ce que Sam ne veux pas voir, qui comprennent ce que Sam ne veux pas comprendre, lui qui pourtant est aussi en sursis, menacé d’être mis à la porte de chez lui, visiblement sans emploi, affichant les signes d’une certaine déchéance (l’odeur pestilentielle qu’il trimballe pendant tout le film).
Le sourire de Sarah l’aura aidé, celui de l’actrice Janet Gaynor aussi (dans un classique du muet, L’HEURE SUPREME de Frank Borzage) à passer de l’autre côté, de l’autre côté de la cour en tous cas pour finir dans les bras de sa voisine hippie. Et quand Sam lui demande ce que peut bien raconter son perroquet qui n’arrête pas de jacasser, elle lui répond « Je me le suis toujours demandé mais je n’ai jamais compris. » Il se peut que parfois les choses n’aient juste pas de sens et pour peu qu’on l’accepte, ce n’est pas bien grave.

La BO du jour
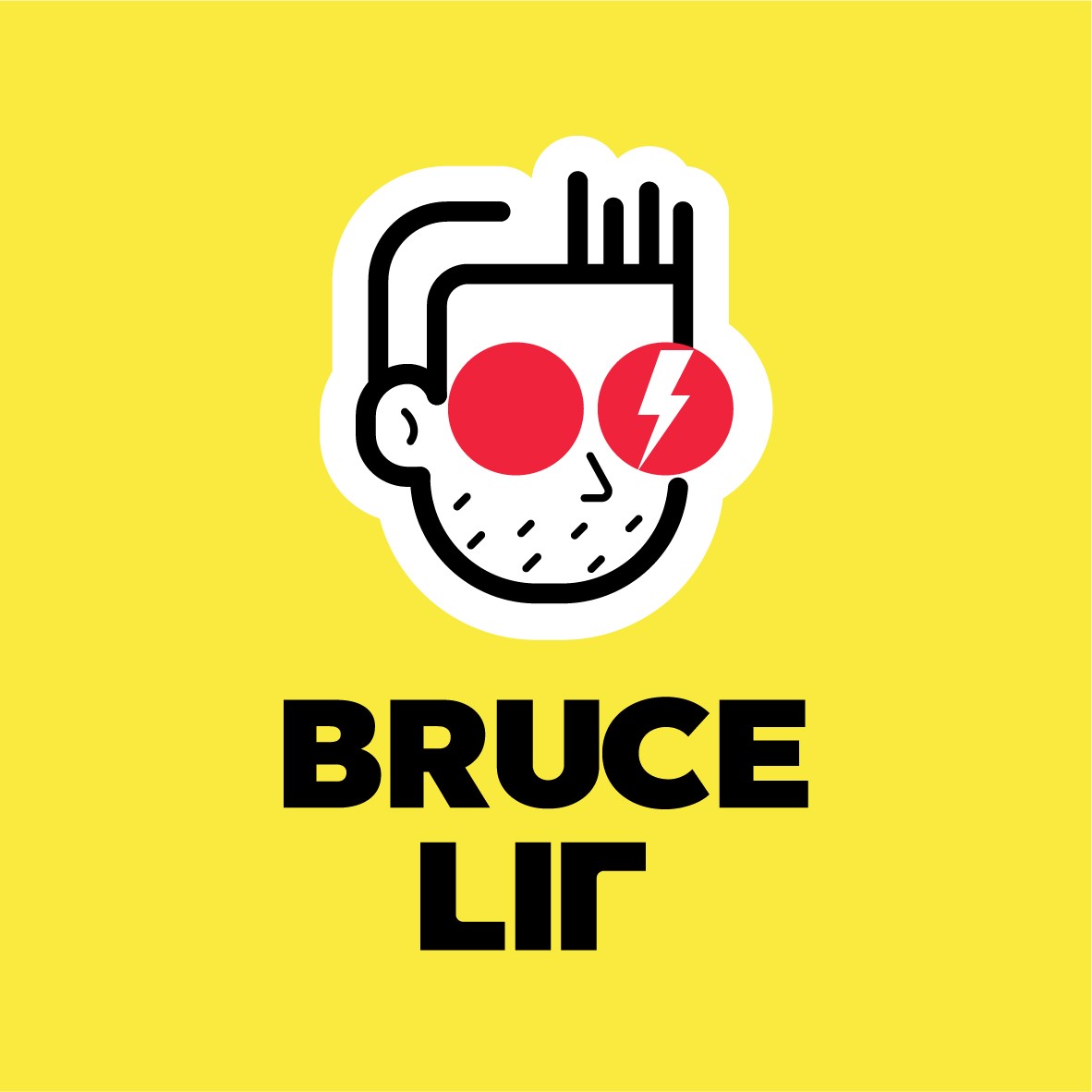
J’ai trouvé cet article fascinant et il m’a interrogé. Il m’est arrivé, en faisant lire une BD à un pote, qu’il passe totalement à côté d’un passage que j’avais apprécié car « il n’avait pas la réf »…
Mais quand une œuvre comporte des tas de références, à partir de quand peut-on dire qu’il y en a trop ? Qu’est-ce qui fait que c’est bien amené ?
Si l’impact est très différent avec la référence, ne s’agit il pas de snobisme ?
Actuellement, j’ai une préférence pour des œuvres plus accessibles mais offrant plusieurs niveaux de lectures.
Le film , sur IMDB, semble diviser entre ses adorateurs et ceux qui trouvent que c’est de la branlette intellectuelle.
C’est une question intéressante mais je pense qu’elle se juge au niveau des pertinences de ces references : j’espère que mon article montre bien à quel point les references permettent à Mitchell d’articuler un propos dont c’est le sujet même.
De toute façon, une œuvre n’existe jamais ex nihilo: elle est dépendante de son contexte, de son époque et un cinéaste la construit forcément avec les œuvres qui l’ont inspirées.
Le spectateur lui-même ne découvre pas une œuvre de manière vierge, jamais, on regarde les films avec les films, les images qui ont éduquées notre regard quelqu’elles soient. Reste à savoir avec quelles images le spectateur forment et éduquent son regard, ca c’est un autre histoire.
De fait, et c’est aussi le sujet d’UNDER THE SILVER LAKE, notre culture de masse est en fait une culture tres éduquée au sens ou elle est bardée de references à maitriser: c’est aussi de ca dont j’ai voulu parler, on est sur BRUCE LIT ici, on parle de comics, or cette culture est devenue une culture de masse mais pour la maitriser il n’en faut pas moins en maitriser les codes et ils sont o combien nombreux et complexes. Je ne suis pas certain qu’un numéro récent des XMEN soit plus accessible qu’un film de Malick ou d’Almodovar.
Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer la capacité du spectateur à éduquer son regard à travers les films (mais aussi la littérature, la BD etc…) et le procès en élitisme a souvent bon dos, plutôt qu’une culture qui donne au spectateur ce qu’il connait et ce qu’il aime (avec toutes les dérives que cela suppose, le film de David Robert Mitchell en parle très bien), pourquoi l’art ne permettrait pas au spectateur de partir à la recherche des œuvres qui permettent d’éclairer le sens de celles qu’il a déja vu, c’est (comme l’explique Pacome Thiellement avec Lynch) une maniérè de le rendre actif et parti prenante du processus créatif.
Je suis circonspect : je pense ne pas lire ton article avant d’avoir vu ce film car tout comme pour IT FOLLOWS, j’ai envie de le voir depuis longtemps (et il m’est toujours passé sous le nez et je ne comprends pas pourquoi). J’ai commencé à lire et fini par me dire que ce sera plus pertinent une fois que je l’aurais vu
La BO : fan. Mauvais album mais ce single m’a toujours foutu la pêche.
oui, n’hesites pas à découvrir le film avec un effet de surprise maximal !
Cela dit, même si j’ai quand même abordé pas mal d’aspects du film, c’est un long métrage qui est tellement dense et plein comme un œuf que je suis loin de l’avoir totalement dévoilé et encore moins d’avoir épuisé toutes ses pistes de lecture, loin de là !
Toujours pas vu le film, même s’il est dans ma pile de films à regarder depuis un bon bout de temps.
Mais comme, j’ai diablement envie de lire ton article, je vais le faire remonter en haut de la pile.
La BO : encore une fois parfaitement choisie et en raccord avec le sujet.
Et bien n’hésites pas à venir me dire ce tu en as pensé ! J’espère que tu aimeras autant que IT FOLLOWS ! Comme tu l’as sans doute compris, je pense que David Robert Mitchell est un des jeunes cinéastes américains les plus doués pour moi, j’espère qu’il pourra continuer sa carrière comme il l’entend et donner la pleine mesure de son talent !
Pop culture à tous les étages et cartographie de Los Angeles, je suis déjà en plein dedans pour l’instant avec la lecture de Les éclats.
Ca faisait 30 ans que je n’avais plus lu Bret Easton Ellis et je le retrouve au top. Fascinant.
absolument ! Excellent livre, du grand Bret Easton Ellis !
The feeling has gone, only you and I, it means nothing to me
This means nothing to me
Oh, Vienna
Je me rappelle que j’écoutais ça en boucle quand j’étais ado.
Il m’a bien eu, le Bret, là…
« Ce monde matériel et illusoire apparait comme une prison, un monde mauvais conçu par un démiurge »
Tiens, tiens, aurions-nous là un film Dickien? On y retrouve la notion de Prison de fer Noire.
Oui il y a de ça, alors pas le Dick auteur de science fiction, mais le Dick qui réfléchit sur la nature de la réalité, le Dick gnostique en fait, il y a peut-être des liens à faire.
Dick réfléchit aussi à la nature de la réalité dans ses romans et nouvelles de SF, souvent. Un exemple : Au bout du labyrinthe.
fr.wikipedia.org/wiki/Au_bout_du_labyrinthe
Étrange façon de commencer un article en nous conseillant d’éviter de le lire !
Mais ça commence fort en citant LE PRIVÉ de Robert Altman, un de mes films préférés ! Pour l’anecdote, un autre film de la même époque nous montre le personnage principal regarder (avec un télé-objectif) son voisinage en pleine liberté des moeurs : « 10 » de Blake Edwards.
Je me souviens être allé à Los Angeles presque à reculons, persuadé d’y trouver une ville moche. Mais effectivement, tout est mythe dans cette ville : le moindre recoin est culte, le moindre coin de rue est musique, cinéma, art, star et paillettes ! Tel quartier, telle ruelle, telle avenue, tel bâtiment, tu l’as vu dans telle ou telle série TV, dans tel ou tel film. Tu as vu un concert filmé dans tel endroit. Du Sunset Boulevard à Mullholand Drive, de Venise Beach à Laurel Canyon, du Downtown à Hollywood Bd, du Hollywood Bowl aux Studios Universal en passant par les quartiers mal famés de Starsky & Hutch jusqu’au désert de Joshua Tree qui se poursuit au-delà de cette mégapole de 10 millions d’habitants, tout est déjà présent dans l’inconscient collectif, et donc dans le tien aussi !
J’ai adoré mon séjour dans cette ville et je rêve d’y retourner un jour.
Bon, ben me reste plus qu’à me regarder ce film, pardi !
J’ai vu LE PRIVE récemment, pour la première fois je pense, et j’ai pas trouvé ça top. C’est sympa, l’ambiance est cool, les acteurs sont super et au top de la coolitude mais au final, ça raconte pas grand chose et je n’ai pas été ébloui formellement ou par l’écriture.
J’adorerai aller à Los Angeles. J’irai voir le mémorial à Elliott Smith déjà.
Jyrille, ben LE PRIVE ça reste un des films majeurs de cette époque du Nouvel Hollywood qui revisite les grands genres du cinéma classique et ouvre la voie au courant du néo-noir (j’ai relu récemment l’intégrale d’ALACK SINNER de Munoz et Sampayo et quand dans une des histoires, on voit le héros passer deux pages à émerger de son lit, a pisser, se raser et se faire un café avec la tête dans le brouillard, j’ai pensé à Elliot Gould qui passe dix minutes du film à chercher de la nourriture pour son chat…) et quand tu dis que ça ne raconte pas grand chose il me semble que c’est assez fidèle au roman de Chandler et même au genre du roman noir tout court dans lequel en fait l’intrigue n’a qu’une importance secondaire, c’est Chandler qui expliquait que dans un roman noir, ce qui est important c’est de créer des scènes et des situations marquantes et qu’après l’énigme policière sert à lier tout ça pour que ça se tienne à peu prés, d’où le fait que certains romans et films noirs soient réputés incompréhensibles, LE GRAND SOMMEIL en particulier ou même l’équipe du film ne pigeait rien à l’intrigue qu’ils étaient en train de filmer, finalement même UNDER THE SILVER LAKE est du même acabit, MULHOLLAND DRIVE j’en parle même pas, mais l’important c’est l’ambiance, l’atmosphère, le fait de se laisser envouter quitte à s’y perdre un peu aussi.
Je pense que tu as totalement raison (toujours pas lu de Chandler pour ma part), mais autant j’ai adoré MULHOLLAND DRIVE, autant ce PRIVE m’a semblé juste sympa. J’ai une bd de ALACK SINNER à lire je crois.
Alack Sinner, c’est extraordinaire. Comme tout ce qu’a produit le duo Jose Munoz – Carlos Sampayo.
Le privé, va falloir que je le remette à mon programme. Je l’ai vu il y a très longtemps et dans mon lointain souvenir j’était passé un peu à côté.
LE PRIVÉ, je l’aime davantage à chaque fois que je le revois. C’est un de mes films culte, pour cette raison qui justement fait les films cultes : une ambiance qu’on adore, dans laquelle on aime se replonger à chaque fois. Pour moi c’est aussi la rencontre entre le polar de Chandler /Hammett et la cool attitude du nouvel Hollywood.
Merci Tornado ! J’espère que le film te plaira autant qu’à moi et peut-être éveillera quelques souvenirs !
L’art américain est en ce moment extrêmement tourné vers lui même, s’auto analysant en permanence et en creusant son propre impact parmi les masses.
C’est à la fois passionnant et redondant.
Je ne connaissais pas du tout ce film et j’aurais au moins la curiosité de le regarder si je le vois passer devant moi.
Merci
Merci à toi !
Cela dit, la culture populaire américaine est surtout occupée à s’auto recycler comme on exploite une richesse proche de l’épuisement plutôt que de produire une vraie réflexion sur elle-même, ce qui reste quand même plus minoritaire !
Pourtant BABYLON (que je n’ai pas aimé) a fait grand bruit et a eu un beau succès il me semble, non ?
Le film n’a pas trop mal marché en France mais c’est une catastrophe industrielle au box-office US.
Quelques doute sur Damien Chazelle. Le bide de BABYLON lui porte préjudice à priori.
A part Whiplash, je reste mitigé sur ses propositions. Il semble vivre constamment dans le passé, dans un âge d’or où il ne cesse de rendre hommage sans jamais arriver finalement à s’en émanciper. J’ai revu LA LA LAND, dimanche soir et je reste sur mon avis d’un film très moyen qui tente de tutoyer les maitres sans jamais finalement s’en approcher réellement (à part la première séquence). Un film sympathique, agréable à regarder mais pas du tout un chef d’œuvre. Finalement l’émotion ne passe pas.
Même constant, en plus froid avec FIRST MAN. A l’arrivée on a du mal à comprendre ce qu’il a envie de nous raconter.
Idem avec THE EDDY sa série Netflix. On s’y perd.
Je n’ai pas tenu longtemps avec BABYLON. Je vais réessayer mais d’entré de jeu j’ai fait une overdose. Je préfère l’approche d’un Baz Luhrmann.
Ce Ludovic est un vrai salopard !
Il me parle de films que je n’ai jamais vus.
Il écrit magnifiquement
L’affiche du film est superbe
IL me parle de rock, de Lynch et de Kubrick, mes cinéastes préférés avec Hitch.
Et, il me met un buste de James Dean !!!
Car, oui j’ai fait une émission sur JAmes Dean recement avec Ludovic https://www.youtube.com/watch?v=x0Lvr-IJMPs
Salaud ! Salaud ! Salaud !
ah ah ah ! et en plus Bruce, l’Observatoire et le buste de James Dean ne sont pas là que pour la citation, ils ont leur petite utilité dans l’intrigue que je n’ai pas dévoilé mais que je vous laisse découvrir…
et oui c’était très bien cette émission à la Taverne de Lug !
Merci d’avoir attiré mon attention sur le youtube James Dean.

Je vais essayer de regarder ça bientôt.
Par contre, ça m’a mené à l’épisode de la Taverne de Lug sur le bilan ciné 2023 avec Ludovic et j’ai vraiment l’impression très troublante d’avoir rencontré mon double.
Merci beaucoup Zen Arcade ! celle là aussi c’était une émission très chouette à faire !
Bonsoir Ludovic.
J’ai un excellent souvenir de ce film. Je souligne la qualité de ton article, car autant que je m’en souvienne j’ai eu globalement la même analyse, très méta, pendant le visionnage sans pour autant avoir l’érudition et la prétention d’y mettre des mots derrière, comme tu viens de s’y bien le faire.
Un long métrage fascinant. Un jeu de piste géant, sans enjeux ou presque où on se perd en effet dans une ville hollywoodienne tentaculaire que l’on croit connaitre par cœur par ses codes. Le vertige en est que plus saisissant.
Le personnage d’A Garfield m’a fait penser à celui de Daniel Quinn du fameux CITY OF GLASS de Paul Auster (que l’on peut élargir à l’ensemble de la trilogie d’ailleurs) avec aussi une femme fatale, plus ou moins chimérique. A noter que Andrew Garfield s’est également perdu, corps et âme en enquêteur reconverti dans le premier volet de l’adaptation de RED RIDING.
Encore un admirateur de R.E.M : mille mercis.
merci Fletcher ! et je suis d’accord avec toi et j’en profite pour répondre à Tornado sur Ari Aster et Jordan Peele, c’est là à mon avis la réussite de UNDER THE SILVER LAKE, c’est qu’il s’apprécie et et procure un vrai plaisir de cinéma au premier degré au-delà de sa complexité et de la richesse de son propos là où les films de Peele et d’Ari Astér (même si je dois avouer que j’aime beaucoup MIDSOMMAR et NOPE à des qualités) croulent sous la lourdeur de leurs intentions. J’espère que le cinéma de David Robert Mitchell continuera de garder cette légèreté, cette désinvolture qui lui permet de faire des films aussi ambitieux sans avoir l’air d’y toucher.
Comme je le disais j’étais à fond avec ces réals, et donc j’ai vraiment aimé (même si ce n’est pas vraiment le terme approprié) MIDSOMMAR. C’est à partir de leurs deux derniers films respectifs (BEAU IS AFRAID et NOPE) que je décroche. Les deux films ont d’indéniables qualités. Mais le premier est pour le coup littéralement interminable et décousu, quand le second nous balance pendant 2h20 des personnages tous absolument insupportables qu’on a envie de fuir (d’où l’ennui). Quand je lis à droite et à gauche qu’on loue les acteurs qui campent des personnages formidables, j’avoue que j’ai du mal à comprendre. Je décroche. Je ne suis pas en phase.
Autant j’ai beaucoup aimé HEREDITE, autant j’ai détesté GET OUT. Je n’en ai pas vu plus de ces deux auteurs pour le moment.
Sinon le Tarantino est en effet très bon et pour avoir enfin vu LES HUIT SALOPARDS (THE HATEFUL EIGHT) récemment, le dernier Tarantino qui me manquait, je l’ai trouvé trop long mais vraiment excellent. Il m’a plus plu que son DJANGO (mais je dois le revoir).
Je remarque qu’on a encore jamais comparé ici David Robert Mitchell avec les grands représentants actuels de l’horreur au ciné (Jordan Peele ou Ari Aster, par exemple). J’étais à fond au départ, mais leurs derniers films respectifs m’ont laissé sur la touche. NOPE et BEAU IS AFRAID sont des films de qualité, mais je m’y suis quand même souvent ennuyé. Par extension, il y a longtemps que je ne me suis pas ennuyé au cinéma. DUNE 2, THE FABELMANS, voilà par exemple des films que j’ai vus récemment où je me suis quand même beaucoup ennuyé. C’est quand même de plus en plus souvent que je suis gagné par cette sensation d’ennui avec le cinoche actuel. Y compris chez les réalisateurs/auteurs confirmés.
C’est que ces films sont interminables non ?
Oui, absolument. Le Aster est fabuleux sur sa première heure (il en dure trois…), ensuite il enchaine les tableaux à la Fellini mais c’est nettement trop long !
Il me parait clair qu’il y a une vraie tendance à l’hypertrophie dans le cinéma commercial américain. En terme de durée, en terme de budget, en terme de recherche de toujours plus de spectacularité,…
On assiste à une désolante (en ce qui me concerne) fuite en avant vers un trop plein de tout dont les décideurs financiers semblent penser qu’il est la seule manière de sauver le cinéma face au streaming généralisé, face aux séries télé. Ce cinéma m’épuise. Physiquement.
Ca ne veut pourtant pas dire que tous les films longs sont mauvais. « Tar » de Todd Field fait plus de 2h30 et me parait passionnant de bout en bout. Pareil pour le dernier Tarantino « Once upon a time in Hollywood » (sans doute un de ses meilleurs) et ses 2h40.
Et si j’élargis le spectre au cinéma mondial, je remarque que ces dernières années, une proportion vraiment importante des films qui m’ont le plus marqué font plus de 2h30, 3h voire même plus de 4 heures.
4h20 pour le film argentin de Laura Citarella « Trenque lauquen » par exemple.
Un de mes films préférés de 2023 tient sur absolument rien et dure 3 heures dont pas une seule seconde ne semble de trop. On y suit les trajets en voiture entre le travail et son domicile d’un employé dans un cabinet d’avocats de la banlieue de Melbourne. Parfois, il est seul, parfois il est accompagné d’un collègue. Il parle, il téléphone à sa femme ou à sa mère (en fin de vie dans une maison de retraite), il écoute la radio, il roule. Le tout avec une camera immobile fixée dans l’habitacle de la voiture. Et ça fonctionne par blocs de trajets qui font, je dirais entre 5 et 20 minutes. Et c’est tout. Et ça dure 3 heures. Et c’est passionnant. Et c’est passionnant parce que ça dure 3 heures. Parce que le film a besoin de se déployer sur cette durée pour fonctionner.
Ca s’appelle The plains, c’est réalisé par David Easteal et c’est une expérience de cinéma magnifique.
Entièrement d’accord pour le Tarantino, qui pour moi est tout simplement son meilleur film et de loin. Je l’ai déjà regardé plusieurs fois et je le trouverais même un poil court, ce qui pour le coup est plutôt bon signe ! ^^
J’en parlais là : brucetringale.com/woodstocks-fall-grandeur-et-decadence-du-mouvement-hippie-en-10-films-et-10-chansons-2-partie/
Tout a fait d’accord sur ONCE UPON A TIME IN HOLLYWWOD.
Film d’autant plus excellent qu’il arrive à désarçonner ceux qui croyait connaitre par coeur Tarantino. Il arrive à se ré-inventer, à amener le spectateur sur de fausses pistes notamment celle de son cinéma. Un grand film qui m’a enthousiasmé tout du long.
Pour en revenir sur les films trop long. tout dépend la proposition de cinéma derrière et si les longueurs sont réellement justifiées. La plupart des film hollywoodien actuels ne rentrent pas dans cette catégorie. C’est de la surenchère pour prolonger inutilement la sauce et masquer les défauts de scénario et le manque de consistance des personnages (oui DUNE, INDIANA JONES 5. MI7 part1 entrent dans cette catégorie, comme tous les films de super-héros …).
L’an dernier j’ai pris un pied pas possible avec FABELMAN et KILLERS OF FLOWER MOON.
Et une de mes plus grosses émotions fut en 2021 avec DRIVE MY CAR de Ryūsuke Hamaguchi qui dure 3h où j’aurais tant aimé 30min plus à partager avec les acteurs et actrices.
Je n’ai vraiment pas accroché avec THE FABELMANS. La réalisation de Spielberg s’est vraiment désincarnée ces dernières années je trouve. Là aussi, les personnages ne sont pas très attachants et l’ensemble est très froid, très long, très monotone (malgré quelques scènes très réussies, je parle évidemment des films dans le film) et particulièrement déprimant. Je trouve que Spielberg a perdu sa magie et en tout cas je suis complètement resté en dehors.
J’ai en revanche assez aimé BABYLON. En le prenant comme un manège dans lequel on s’engouffre, ça a fonctionné. Je ne crie pas au chef d’oeuvre, mais j’ai trouvé que c’était un sacré spectacle, purement cinématographique.
Tous ces films dont on parle, ils ne sont pas mauvais, ces réalisateurs sont très bons, mais je sais pas… Ces dernières années, la « magie du cinéma » ne fonctionne pas beaucoup avec moi (et je ne parle même pas des films de super-héros et autres blockbusters…).
J’ai adoré Whiplash et j’ai vu La La Land pour la première fois dimanche, j’ai beaucoup aimé, j’y ai cru. C’était beau. Peut-être pas un chef d’oeuvre mais ça n’entre pas en ligne de compte pour moi. Il date de quand, le vrai dernier chef d’oeuvre que vous avez vu ? En est-ce un, considéré comme tel par presque tout le monde ? Pas aimé The Eddy, trop vide et trop ennuyeux.
Je ne me suis pas du tout ennuyé dans les deux Dune ni dans The Fabelmans (qui m’a bien plu). Alors que Fletcher a raison pour MI7. A l’exception de deux très longues et excellentes séquences d’action, j’ai trouvé tout le reste pénible. On est loin de GHOST PROCOTOL, le meilleur de la franchise pour moi.
J’ai vu un film où un gars parle au téléphone pendant une heure et demi dans sa voiture, de nuit, en roulant. C’est Tom Hardy dans le rôle de Locke, titre du film. C’est un peu facile mais si bien tourné et écrit (et joué, ses correspondants sont très bons, il y a même Olivia Colman) que j’ai passé un bon moment.
« Il date de quand, le vrai dernier chef d’oeuvre que vous avez vu ? »
Là, comme ça, sans trop réfléchur, je dirais Pacifiction d’Albert Serra.
Sinon, une petite liste des films que j’ai trouvé les plus marquants de ces deux dernières années : Licorice pizza de Paul Thomas Anderson, The souvenir de Joanna Hogg, Enquête sur un scandale d’état de Thierry De Peretti, Il buco de Michelangelo Frammartino, Qui à part nous de Jonas Trueba, Sous le ciel de Koutaïssi d’Alexandre Koberidze, Contes du hasard et autres fantaisies de Ryusuke Hamaguchi, Anatomie d’une chute de Justine Triet, Fermer les yeux de Victor Erice, N’attendez pas trop de la fin du monde de Radu Jude, Désordres de Cyril Schaublin, Trenque Lauquen de Laura Citarella, The plains de David Easteal et tous les Hong Sang-Soo sortis ces deux dernières années.
Il y a plein de films excellents à voir dans le cinéma mondial contemporain, cinéma dont les Etats-Unis sont aujourd’hui loin de constituer le centre.
Merci pour toutes ces pistes, Zen. De ta liste, je n’ai vu que Anatomie d’une chute, que j’ai trouvé très très bon, mais que je ne qualifierai pas de chef d’oeuvre pour ma part.
J’ai récemment vu Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson, j’étais sûr que c’était pour moi et finalement je n’ai pas aimé du tout, j’ai trouvé ça prétentieux et faux malgré de très belles images.
Mazette quel article !!! Quelle analyse riche et accessible !!! Total respect.
Toute rébellion est illusoire puisque celle-ci n’est que le produit d’un système qui conspire à entretenir cette illusion. – Une pensée qui fait froid dans le dos, et en même temps en y repensant de nombreux rebelles ont réussi, y compris à l’époque contemporaine, à produire du neuf, à dépasser le système, qui parvient souvent à l’instrumentaliser dans une récupération mercantile… mais pas toujours.
Un article véritablement fascinant, qui donne à réfléchir, merci beaucoup.
Merci Présence !
en effet, ça permet de s’interroger sur beaucoup de choses, ce n’est pas pour rien que beaucoup de cinéastes sont nostalgiques de l’époque des studios et de ce que Scorsese appelait les cinéastes contrebandiers car dans les contraintes imposées par le système des studios ils arrivaient en sous-main a faire passer des choses que personne n’aurait penser trouver dans ces films là et qui pouvaient avoir un vrai pouvoir de subversion.
Aujourd’hui le cinéma hollywoodien revendique la toute-puissance qui permet de faire passer un propos ou un message à travers un blockbuster de consommation courante mais en adoptant le langage et la forme la plus dominante, celle de la publicité et du consumérisme le plus banalisé sans jamais remettre cela en cause, on peut se demander à quoi cela sert…
Un bel article d’une vaste érudition ! (Mais quand même, c’est tricher de mettre un buste de James Dean)
Je crains de pas mal m’identifier au protagoniste, j’ai beaucoup tendance à analyser par référence, au risque de tourner en rond.
Je vais tâcher de trouver ce film ^^ Merci pour cette découverte.
Ah ben voilà, j’ai vu le film.
Pour être honnête, je ne vais pas dire que j’en sors enthousiasmé.
Je crois que The myth of the american sleepover, plus modeste mais plus touchant à mes yeux, reste mon film préféré du réalisateur.
Ceci dit, je pense le film assez riche pour se livrer à de multiples interprétations et ça joue plutôt en sa faveur.
On ne pourra pas passer à côté du portrait de Los Angeles, qui se matérialise par une prolifération narrative ludique et fantasmatique qui ne cesse de convoquer à la fois les références geeks et les références cinéphiles dans un tourbillon qui peut apparaître un peu vain et replié sur lui-même. En l’état, le film m’agace souvent plus qu’il ne me convainc.
Ce qui le sauve à mes yeux, c’est qu’on peut aussi le voir plus simplement comme le film d’un gars qui ne parvient pas à se remettre de sa séparation avec son ancienne copine.
L’ancienne copine, on ne la voit que dans une courte scène, ils se revoient rapidement et par hasard dans une fête. Elle est accompagnée par son nouveau fiancé. Et pour la première fois dans le film, qui n’a jusqu’alors pas cessé de nous projeter dans un univers fantasmatique, on a l’impression d’assister à quelque chose qui relève du réel. C’est pour moi la scène pivot du film.
A l’instar de l’affiche publicitaire qui annonce « I can see clearly now » (sur laquelle on voit d’ailleurs l’ancienne copine), c’est tout le jeu de piste formel du film qui s’éclaire. C’est comme si le héros du film avait besoin de se perdre dans des signes à décrypter à l’infini pour donner un sens à ce qui lui est arrivé. Alors qu’il n’y a pas de sens caché. Sa copine est partie et c’est comme ça.
Et la fin du film avec l’abandon de l’appartement, l’abandon du jeu de pistes et du décryptage de signes cachés (le cri du perroquet ne veut rien dire) nous montre l’aboutissement du parcours d’un héros qui s’est enfin libéré du poids de la séparation. Il peut revivre. Dans le monde réel.
Ayé, vu !
J’ai totalement adoré. LE film absolument taillé sur mesure pour le spectateur que je suis devenu : Fantasmagorique, envoûtant et anti-naturaliste, gorgé jusqu’à la lie et de manière roborative de toutes mes références culturelles préférées, comme un jeu de piste.
Le concept du film est (mais c’est expliqué dans l’article) absolument géniallissimesque : Une ville (Los Angeles/Hollywood), est avec le temps bâtie sur tant et tant de mythes, même s’ils sont avant tout culturels, fictifs et fabriqués, qu’elle en est devenue mythologique, et par extension surnaturelle !
En 2h20, le réal parvient à explorer tous les thèmes, les sous-thèmes, le sous-texte (effectivement l’histoire d’un jeune gars brisé par une rupture amoureuse, qui cherche à se reconstruire et à retrouver sa voie), ainsi que tous les éléments d’une vaste métaphore de tout ce qui ne va pas dans tout le monde réel (génial, aussi, ce parallèle entre les « dieux » d’Hollywood et les pharaons égyptiens – sans oublier le rôle d’objet-sexuel des starlettes, épouses/esclaves de nababs partouzeurs).
Je suis certain que le film fonctionne encore davantage si l’on connait Los Angeles. La claque mythologique que représente la visite de cette ville est évidemment idéale pour être particulièrement réceptif au sujet du film.
Un grand merci à Ludovic pour cette découverte. Le chainon manquant, en ce qui me concerne, entre MULHOLLAND DRIVE et DONNIE DARKO.