
Cet article propose un tour d’horizon sur un thème particulier : La chute de l’idéologie hippie.
S’il s’inspire des TOP 10 musicaux que l’on trouve régulièrement sur le blog, il n’est pas essentiellement dévolu à la musique, mais aussi (et surtout) au cinéma ! L’idée est de marquer la fin d’une époque par le truchement de quelques films et de quelques chansons qui la mettent en scène.
Vous trouverez la 1° partie de l’article ici.
Le thème de cet article n’est pas le Mouvement Hippie. Si tel était le cas, nous y aurions trouvé une sélection de films complètement différente.
Vous n’y verrez donc pas les documentaires des festivals de MONTEREY POP, d’ALTAMONT ni même celui de WOODSTOCK. Vous n’aurez rien sur les films emblématiques de l’image du hippie ou de son mode de vie, comme HAIR ou, plus récemment, le très beau HOTEL WOODSTOCK d’Ang Lee.
L’idée, ici, est de parler de la fin d’une époque et d’une utopie, d’un moment où la civilisation a failli changer pour un monde meilleur, et où elle s’est en réalité écroulée bien plus bas qu’elle ne l’était auparavant. Un moment charnière de notre époque moderne, très intéressant à analyser et à étudier.
Ce passage d’une époque à une autre, d’une idéologie à sa chute, d’une philosophie utopique à la réalité imparfaite de l’homme a nourri l’inspiration d’un tas de cinéastes, de musiciens et de chanteurs. C’est cela dont parle notre article. N’oublions pas que la maxime du blog Bruce Lit est bel et bien : « De la culture Geek à la culture tout court »…
Allez hop ! C’est reparti :
6. MASSACRE A LA TRONÇONNEUSE (1974)

© Bryanston Distributing Company, Vortex Inc.
On a à peu-près tout dit sur ce film d’horreur fondateur, dont l’impact est aujourd’hui encore intact, malgré l’absence totale d’effets de gore sanguinolent (et c’est sans doute la raison pour laquelle il vieillit aussi bien, toute l’horreur se dissimulant dans l’esprit du spectateur plutôt que sur l’écran). Initiateur du genre Slasher, redoutable critique sociale sur les affres de la société industrielle rendant obsolète toute une population d’ouvriers et d’artisans qu’on préfère oublier dans leur trou à rat, parabole sur la lutte des classes… Et un extraordinaire laboratoire de trouvailles en termes de mise en scène de l’horreur, autant du point de vue des images que du son.
Pour le coup, et pour changer un peu, il est très intéressant d’éclairer le premier film de Tobe Hopper sur la thématique qui nous intéresse ici.
Un épisode de la série animée SCOOBY-DOO. Voilà exactement ce à quoi ressemble le pitch de MASSACRE A LA TRONÇONNEUSE ! La preuve par écrit : Cinq jeunes américains (deux garçons, deux filles, et on remplace le chien par un handicapé) sillonnent une région reculée des USA (ici le Texas profond) à bord d’un minibus. Egarés, ils cherchent de l’aide auprès des habitants et tombent sur un dégénéré masqué (le terrifiant Latherface, qui deviendra l’un des plus mythiques croquemitaines de l’histoire du cinéma)… Voilà, c’est exactement pareil qu’un épisode de SCOOBY-DOO (dont la première diffusion remonte à 1969, l’année du festival de Woodstock), d’autant que la bande de jeunes de MASSACRE A LA TRONÇONNEUSE porte pantalon à pattes d’éléphant et chevelure fournie. Sauf qu’ici, il n’y a pas de mascarade, et qu’on va au fond du sujet, parce que ce n’est pas un cartoon mais bel et bien un film d’horreur !
La seconde moitié du film est un cauchemar hallucinant de folie meurtrière et de monstruosité humaine ou le glauque se dispute au malsain. Et la séquence du « déjeuner » familial de la ferme de Latherface et de ses congénères est proprement hallucinante de cruauté cathartique, bien qu’encore une fois il n’y ait quasiment aucune effusion de sang !
Une fois qu’on a bien en tête cet angle « à la SCOOBY-DOO », on est totalement raccord avec le thème de notre article : MASSACRE A LA TRONÇONNEUSE confronte les hippies aux rednecks. Soit deux générations d’américains aux valeurs opposées. La première est censée remplacer la seconde, laquelle semble décidée à ne pas se laisser faire et à se venger dans les grandes lignes. Ainsi le film s’impose telle une métaphore sur l’élimination d’une idéologie nouvelle par celle d’avant, archaïque et toujours profondément ancrée dans le terreau le plus profond de la nation humaine. Tout simplement l’élimination de l’idéologie hippie par l’Amérique traditionnelle et réactionnaire…
L’originalité du film repose beaucoup sur le traitement du son, le réalisateur remplaçant dès qu’il le peut la musique de situation par les bruits de la diégèse, notamment celui de la tronçonneuse qui s’engouffre dans les oreilles du spectateur durant toute la durée du dénouement final. Pour le coup c’est bien cette bande-son-là que nous sommes obligés de choisir, le film ne comportant d’ailleurs pas de chanson, contrairement aux autres de la sélection.

7. APOCALYPSE NOW (1979)
Le pitch : 1969, en pleine guerre du Vietnam. Depuis Saigon, le capitaine Willard (Martin Sheen) reçoit la mission d’assassiner le colonel Kurtz (Marlon Brando), devenu fou. Ce dernier s’est retiré au Cambodge, au cœur des ténèbres de la jungle, d’où il mène une guerilla sanglante à la tête d’une armée de renégats de tous bords, fanatiques qui l’idôlatrent tel un dieu vivant.
Willard et ses quatre soldats embarquent alors sur une frégate afin de remonter le fleuve. Au fil de leur périple, ils découvrent un monde sauvage dans lequel l’humanité semble avoir totalement disparu…
Commencé en 1974 et achevé en 1979, APOCALYPSE NOW marque à la fois l’apogée et les limites du Nouvel Hollywood, voire son effondrement. Effectivement, jamais le cinema underground n’aura connu d’époque aussi faste, où l’on pouvait financer un film d’auteur dans des proportions aussi colossales. Mais, livré à lui-même, l’auteur, à savoir un Francis Ford Coppola tout aureolé de son immense succès après les PARRAIN 1 & 2 (Oscar du meilleur film pour les deux !) et CONVERSATION SECRETE (Palme d’or), doit assumer ses choix artistiques : Désirant tourner son film dans la jungle des Philippines, Coppola se retrouve rapidement coupé du monde et accumule les catastrophes (typhon, destruction et reconstruction de décors péplumesques, crise cardiaque d’un Martin Sheen défoncé en permanence, caprices d’un Brando refusant que l’on filme son obésité en pleine lumière et qui ne connait pas son texte, dépression nerveuse et tentatives de suicide pour le réalisateur, et un dictateur des Philippines qui prête ses hélicoptères à l’équipe du film mais qui les réquisitionne en plein tournage pour sa guerre civile. Etc.). Une odyssée de l’enfer, baignée dans la drogue, qui fait écho au film…
A l’origine, APOCALYPSE NOW est la transposition dans la guerre du Vietnam du roman AU COEUR DES TENEBRES de Joseph Conrad. Le thème du récit (jusqu’à quel point un brilliant humaniste (le colonel Kurtz), peut-il embrasser la cause d’un peuple à l’opposé de ses convictions et de son éthique sans perdre ses propres valeurs et, au final, son esprit et son âme ?), est nourri par une construction narrative fascinante (on pourrait dire une montée en puissance), le capitaine Willard et son équipe remontant symboliquement le fleuve comme s’ils remontaient le temps à la recherche des causes de cette chute, de cette âme, damnée dans le noyau de l’enfer…
Une épopée hallucinante et hallucinée, qui retranscrit de manière terrifiante la folie d’une guerre absurde entre deux peuples complètement déconnectés l’un de l’autre.
A l’origine, le film devait être réalisé par George Lucas, qui choisit finalement l’aventure STAR WARS. Le scenario est de John Milius. Il reprendra le même final, à la lettre, dans son CONAN LE BARBARE : Le héros, sur le point de remplacer celui qu’il est venu assassiner en devenant le nouveau dieu vivant de toute une armée de fanatiques, renonce à cet héritage.
Une fois encore, en choisissant d’éclairer le film sous notre thématique du crépuscule hippie, on peut faire ressortir deux ou trois choses : le colonel Kurtz, qui cherche à construire une civilisation parallèle en revenant aux valeurs séminales de la nature humaine primitive, fait écho (dans une déformation malsaine qui en dénonce l’absurdité et le danger) aux préoccupations des hippies. Willard et ses soldats, dont certains recherchent systématiquement l’évasion et le salut dans le sexe et la drogue, forment la deuxième face d’une même pièce. Et d’une même impasse.
Indissociable du mouvement hippie qui nait dans sa contestation, la guerre du Vietnam connait là sa première transposition véritable dans l’histoire du cinema (si l’on considère que le tournage commence en 1974). Le film retranscrit ainsi le malaise et l’effondrement idéologique de toute une époque.
Enfin, il y a les Doors…
Le film de Coppola est aujourd’hui lié à THE END, la chanson qui transcende les images de l’ouverture du film et de son dénouement cathartique final. Rarement un titre de l’histoire du rock aura autant fait corps avec un film au point de tisser avec lui des liens allant bien plus loin que la seule alchimie son/image. Ici, l’image et le texte s’enrichissent constamment l’un et l’autre et acquièrent sans cesse des couches de sens successives, tandis que la musique accentue la sensation psychédélique qui fait écho à la manière dont les soldats embrassent une guerre qui les dépasse complètement.
Malgré un tournage et une postproduction chaotiques, APOCALYPSE NOW (seconde Palme d’or pour Coppola) connaitra un succès considérable. Il faut avouer que le film impressionne et gagne royalement ses jalons de classique : Quel autre film peut se targuer d’être à la fois une œuvre d’auteur au sens noble du terme, un film profond et philosophique doublé d’un grand spectacle jouissif et intense, une allégorie de la folie de la guerre aux images magnifiques, sublimées par un extraordinaire travail sur la lumière.
Il fallait bien les Doors, probablement l’un des groupes les plus complets de l’histoire du rock, pour accompagner cette odyssée cinématographique. Là aussi, quel autre groupe aura réuni une telle inspiration, une telle richesse musicale, une telle profondeur poétique des thèmes, une technique collective aussi aboutie et un charisme incandescent aussi définitif, véhiculé par un frontman et sex-symbol à ce point emblématique de toute une époque ?
8. THE DOORS (1991)
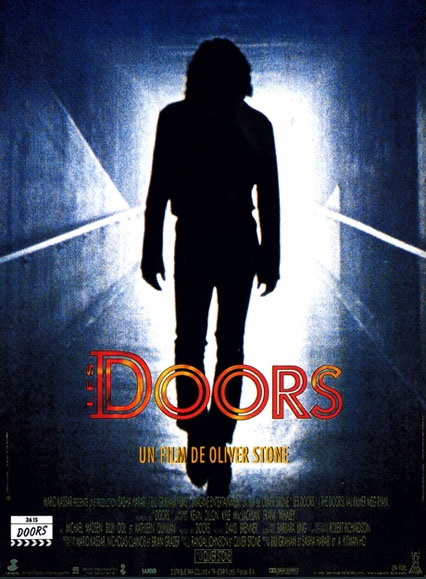
© Columbia TriStar Films
Oui, encore les Doors. Car on ne peut décemment pas aborder un thème comme celui de notre article sans developer cette rencontre entre le mythe et la réalité, ce phénomène culturel que représente ces stars du rock tombées sous les excès, symboles de cette impasse, de cette chute dans l’abîme du gouffre, ouvert avec la revolution de la génération flower-power.
J’étais au lycée lorsque le biopic d’Oliver Stone est sorti. Je me passionnais alors pour la musique des années 60 et 70. C’était l’époque des découvertes et des expressions comme “Sexe, Drogue & Rock’n roll” avaient une très forte résonance. J’étais donc le cœur de cible parfait pour le film, objet de culte instantanné.
Dans son autobiographie, le claviériste des Doors Ray Manzarek ne tarit pas d’aigreur sur ce biopic, qu’il conchie à grands coups de “Oliver Stone has assassinated Jim Morrison“, quand il ne crie pas carrément que le film est une merde sans nom et qu’il a complètement ruiné l’image de son groupe.
Oliver Stone a écrit et réalisé le film qu’il fantasmait depuis son adolescence. C’est un projet personnel et nul doute qu’il y décrit SON Jim Morrison avec beaucoup de sincérité mais c’est forcément Ray Manzarek qui a raison : Avec le recul, ce biopic est bourré de clichés ridicules sur la figure chamanique de la star du rock psychédélique et décrit Jim Morrison de manière totalement biaisée en le transformant en chantre de la destruction, sorte de polichinelle illuminé jouant à gros traits le poète maudit en déblatérant sans cesse des inepties rabattues sur l’ouverture de l’esprit aux forces célestes et autres crétineries hippies périmées. Le Jim Morrison du film est un homme violent, vulgaire et naïf alors que le vrai était apparemment l’inverse, érudit, sensible, introspectif, calme au quotidien et extrêmement cérébral, qui ne dérivait que lorsqu’il était complètement saoul (ce qui arrivait souvent mais pas continuellement).
Ainsi, la moitié du film au moins est un tissu d’âneries. N’empêche qu’avec cette information en tête, on peut quand même aimer le biopic d’Oliver Stone, car ses qualités sont nombreuses, à commencer évidemment par l’interprétation immersive de Val Kilmer, qui se transforme littéralement en Jim Morrison, bouge à l’identique et habite le rôle au point de troubler les anciens membres des Doors, qui salueront unanimement sa performance (même Manzarek). La restitution de l’époque est au diapason et assure le voyage dans le temps en s’inspirant d’images d’archives. Le tout est brillamment filmé, ponctué de morceaux de bravoures et, surtout, offre au cinéma les plus grandes reconstitutions de concert rock de son histoire. Là aussi la performance des acteurs impressionne puisque ce sont eux (les quatre interprètes des Doors) qui jouent et chantent en live (tous ont reçu une formation de musicien afin d’interpréter leur rôle !), et Val Kilmer réussit encore à être très convaincant en interprétant toutes les chansons live, dans lesquelles il parvient à faire revivre le chanteur malgré un timbre de voix sensiblement différent.
Ces reconstitutions de concerts, filmées sans effets spéciaux, avec des milliers de figurants, d’une complexité inouïe (la caméra filme tous les coins du spectacle, depuis les coulisses jusqu’à la scène, la fosse et les gradins du public, en temps réel puisque les acteurs interprètent littéralement le concert !) sont, qui plus-est, doublées d’une dimension onirique, les personnages qui hantent l’esprit du chanteur (l’allégorie de la Mort, le chef indien dont l’âme aurait rejoint la sienne) participant à la scène ! Là aussi, on peut trouver le cliché ridicule, mais la prouesse filmique emporte l’adhésion : Ces incursions oniriques transforment les concerts en messes cérémoniales, incantatoires, véritables cabales dans lesquelles le chanteur devient ce fameux « chamane », lequel tourne en rond autour d’un feu imaginaire et convoque le public, hypnotisé, à une véritable expérience mystique et mythologique.
Verdict final : Le film raconte un peu n’importe quoi sur Jim Morrison, mais c’est un sacré spectacle sur le mythe du rock !
Les impressionnantes scènes de concert filmées en live ! (bis)
Fidèle à lui-même, Oliver Stone montre l’envers du décor de son pays. Ici, il dénonce la répression qu’a subit la jeunesse hippie (des policiers étaient sur scène à chaque concert, prêts à se jeter, à la moindre occasion, sur un Morrison incarnant la décadence), immédiatement tombée dans le collimateur de l’Amérique puritaine (époque Nixon). Bien que l’on perçoive un cinéaste politiquement engagé, Stone ne magnifie pas pour autant l’idéologie hippie et montre clairement sa chute, alors que le film s’arrête avec la mort de Morrison, qui rejoint Jimi Hendrix et Janis Joplin dans le Club des 27 (toutes les stars du rock décédées tragiquement à l’âge de 27 ans).
Fan des Doors depuis le lycée, j’aime moult chansons de leur courte mais exceptionnelle discographie. On va écouter ma préférée, RIDERS ON THE STORM, sans extrait du film (il est temps de voir les vrais Doors), pour une fois.
9. FORREST GUMP (1994)
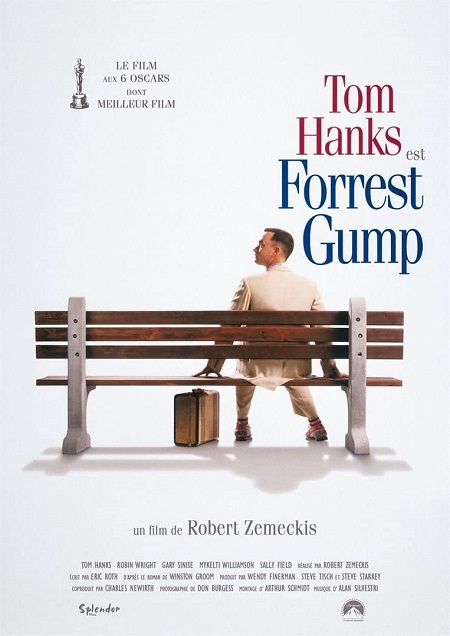
© Paramount Pictures
Le meilleur scénario de tous les temps. Je n’en démordrai jamais (il a obtenu l’Oscar d’ailleurs, ainsi que ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur…). Quel coup de génie ! Quelle écriture !
Forest Gump est un simple d’esprit (QI à 75 !). Obligé de courir sans cesse afin d’échapper aux autres gamins qui en font leur souffre-douleur, il devient alors un athlète capable d’affronter la vie. Il traverse son époque en se retrouvant systématiquement mêlé, sans qu’il n’en ait conscience, à tous les événements qui ont marqué l’Amérique des années 50 aux années 80, de l’avènement du rock’n roll à celui du sida, illustrant le tournant de notre époque.
Forest n’est pas qu’un spectateur mais bel et bien un acteur de ces événements, voire une source d’inspiration pour les célébrités qu’il rencontre (il inspire notamment Elvis Presley pour son déhanchement et John Lennon pour les paroles de la chanson IMAGINE !). Il est là dès qu’un nouveau président apparait à la télévision, déclenche le scandale du Watergate, assure la réconciliation entre les USA et la Chine (en jouant au ping-pong !), et génère moult phénomènes culturels, sans jamais le faire exprès !
Dans la tradition des grands films sur le Vietnam depuis APOCALYPSE NOW, FOREST GUMP aborde le sujet sans une once de manichéisme et l’incorpore parfaitement dans le paysage américain, depuis lequel s’élève la contestation hippie représentée dans le film par la figure historique de Jerry Rubin, militant emblématique de la fin des années 60 (et inspirateur du Mai 68 français).
Le personnage de Jenny Curran (Robin Wright, magnifique) mène une existence parallèle à celle de Forest en épousant toutes les évolutions de la contre-culture et en embrassant complètement le mouvement hippie. Un temps toxicomane, elle finira séropositive, incarnant à elle-seule la montée et la descente de cette génération révolutionnaire.
Imagine… John Lennon !
L’idée forte du film est de mettre en scène la vie d’un homme simple d’esprit, qui traverse une époque de l’épopée humaine aux multiples bouleversements, sans s’apercevoir du désastre. Perpétuellement désintéressée, la vie de Forest Gump est une véritable geste chevaleresque, exemplaire, oubliée et perdue dans le génome humain…
Géniale enfin, cette idée forcément poétique de narrer une histoire romanesque par le biais d’un personnage simplet, désamorçant ainsi systématiquement la moindre scène sirupeuse avec humour et distanciation… La plume qui s’envole lors du générique final symbolise ainsi autant le personnage principal que le spectateur, qui vient lui aussi de traverser le film avec une infinie légèreté, tandis qu’on vient de lui conter trente années d’une civilisation en train de se ratatiner…
Célèbre pour ses séquences de reconstitutions d’images d’archives filmées, dans lesquelles Tom Hanks a été incrusté (il donne ainsi la réplique aux vrais présidents, au vrai John Lennon, etc, pour un résultat génialement hilarant !), le film est également ponctué de scènes d’une beauté extraordinaire, notamment celle où Forrest décrit à Jenny la guerre du Vietnam, dont l’alchimie entre les images et le monologue sont d’une magnifique poésie. Du très, très grand cinéma populaire, intelligent, profond, inspiré, poignant et incroyablement didactique.
Evidemment les bienpensants conchient le film de Robert Zemmeckis en y trouvant un moralisme sirupeux insupportable. A croire que l’on n’a pas du tout vu la même œuvre car, si Forrest vit l’Histoire de l’Amérique, il nous la fait découvrir avec un regard affranchi de toute interprétation.
Etant un homme simplet (osons dire un imbécile), Forest raconte l’histoire des USA de manière extrêmement simpliste. C’est donc au spectateur d’en prendre conscience et de rechercher le véritable sens de l’histoire. Les spectateurs qui ont pris au premier degré les allégations d’un homme simplet (et qui ont vu un film sur la glorification des idiots (et n’ont même pas remarqué que la dépression nerveuse du héros, qui se met à courir à travers l’Amérique, dure quand même trois ans…)) sont donc, soit aussi imbéciles que lui, soit des spectateurs n’ayant strictement rien compris au film…
Effectivement, c’est en partant du principe que le personnage possède une compréhension du monde extrêmement limitée que le sous-texte du film devient accessible : FOREST GUMP dénonce la violence d’un pays qui, sous ses beaux atours de terre de liberté, cherche sans cesse à réécrire son histoire, à effacer ses erreurs en misant sur la crédulité du peuple, à masquer ses aberrations, à éradiquer la libre pensée, le libre-arbitre, la libre émancipation, etc. Il fait donc parfaitement écho à notre thématique : En tentant de changer le monde depuis l’Amérique, le mouvement hippie a généré un monstrueux retour de bâton.
Tout le film est ponctué de morceaux de l’histoire du rock contemporaine du récit (48 titres en tout !). On pourrait encore choisir un titre des Doors (il y en quatre dans le film !), mais on va changer un peu :
10. ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD (2019)
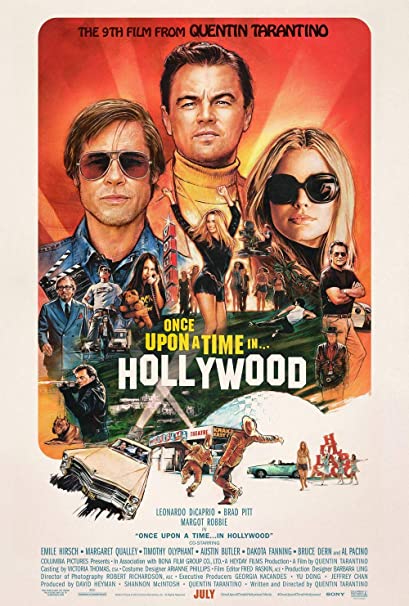
© Columbia Pictures
Peut-on réécrire l’histoire de l’assassinat de Sharon Tate et de ses invités par la « famille » de Charles Manson ? Quentin Tarantino l’a fait avec ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD en nous racontant également, en toile de fond, la naissance du Nouvel Hollywood, le passage d’une époque à une autre et… la mort de l’idéologie hippie !
En nous contant l’histoire fictive de Rick Dalton, une star de séries télévisées western sur le déclin (Leonardo DiCaprio, touchant et déjanté) et de sa doublure-cascade (Brad Pitt dans son meilleur rôle), l’auteur de PULP FICTION nous raconte en réalité notre véritable histoire (et plus exactement celle de l’Amérique), telle qu’elle aurait dû être !
Fan du vieux cinéma hollywoodien autant que de ses petites séries B, Tarantino redonne tendrement vie à cette période où le cinéma classique a été supplanté par le très noble cinéma d’auteur dont faisait partie Roman Polanski, dont le personnage apparait bien évidemment dans le film (il venait d’épouser Sharon Tate, laquelle était enceinte de huit mois au moment de son assassinat, et ils avaient racheté la villa du producteur Terry Melcher à Hollywood, dont voulait se venger Charles Manson après qu’il ait refusé de produire son disque). Pour autant, il célèbre également les valeurs de noblesse associées à cette période déclinante du vieil Hollywood en faisant de leurs acteurs (dans tous les sens du terme), les héros qui n’existaient plus en cette fin des années 60, tandis que les hippies, soi-disant porteurs de la nouvelle idéologie humaniste, massacraient des gens sans défense de la manière la plus barbare et la plus sordide qui soit.
Avec un génie insolent, Tarantino réussit une allégorie complète de ce moment où le monde s’est transformé, en mêlant le cinéma et le réel, l’histoire et la fiction, la petite histoire et la grande.
Tourné telle une fresque historique (le film dure 2h41), ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD est tellement truffé de références culturelles qu’il vaut mieux avoir les clés pour l’apprécier dans toute sa richesse. Nonobstant ce dernier point, il est possible également de le revoir indéfiniment afin d’y glaner ici et là tous ces clins d’œil, ces citations et autres restitutions issues de la culture populaire et artistique de l’époque consacrée.
Œuvre-somme, le film s’adresse autant aux amateurs de cinéma d’art et d’essai qu’aux geeks fans de cinéma bis en nourrissant sa mise en scène de cette écriture à la fois dense et fun qui a fait le succès de son auteur.
Au rayon des scènes les plus jouissives, il y a bien entendu la visite tendue du ranch de la « Famille Manson » effectuée par le personnage de Cliff (Brad Pitt), l’affrontement cathartique final, mais aussi le combat entre Cliff et Bruce Lee ! C’est un moment néanmoins étrange car, après avoir rendu un hommage à la star du karaté dans KILL BILL, Tarantino semble ici le ridiculiser ! Là encore, la mise en scène brillante du cinéaste mérite d’y voir plus loin et de redonner sa chance à la séquence : On s’aperçoit alors qu’il s’agit d’un flashback et plus précisément du souvenir de Cliff. Ce faisant, en mettant en scène la vision probablement déformée du personnage, roublard et un peu prolo, qui se remémore la scène en sa faveur, Tarantino dénonce peut-être les préjugés dont a longtemps été victime l’acteur d’origine chinoise…
Parmi les références les plus évidentes, Rick Dalton apparait rapidement comme un amalgame des acteurs ayant connu la mutation de cette époque en ayant réussi le transfert depuis les séries TV western populaires jusqu’au cinéma international regroupant également les pays européens (Steve McQueen interprété dans le film par Damian Lewis, quasiment un sosie, Burt Reynolds qui devait jouer dans le film mais est décédé juste avant, et bien entendu Clint Eastwood).
Comme d’habitude, Tarantino ponctue son film de chansons. J’ai choisi une reprise : le CALIFORNIA DREAMIN’ façon latino par José Feliciano. Sachant que le mouvement hippie est né à San Francisco et s’est épanoui en Californie, voilà un beau final pour le thème de notre article, non ?
Avant de terminer, je tiens à préciser que je n’ai pas pu mettre tous les films que j’avais listés à cette intention. Il manque ainsi à cette liste encore plusieurs films dont j’aurais voulu parler : LES CHEMINS DE KATMANDOU, ZABRISKIE POINT, FRITZ THE CAT, MIDNIGHT EXPRESS, LAS VAGAS PARANO et THE ICE STORM d’Ang Lee (voire même INHERENT VICE de Paul Thomas Anderson, même si c’est une daube). Si jamais cela vous intéresse, dites-le moi…
Et voilà. C’est terminé.
On sait que certains thèmes sont tabous, principalement aujourd’hui que notre société est gangrénée par les bienpensants et leur nouvelle dictature des idées. Et pour le coup le présent article en touche deux : Dire que c’était mieux avant (car si l’idéologie hippie a proposé un changement, le retour de bâton effectué en riposte, ainsi que ses excès, ont laissé le monde bien plus mal qu’il ne l’était juste avant), est intolérable pour les « progressistes ». Et insinuer que l’intouchable et séminale idéologie soixante-huitarde a précipité la chute du monde moderne, ça l’est peut-être encore davantage…
Et pourtant c’est un fait : Plus on avance, plus notre monde est fou, surpeuplé, violent, hypocrite, communautariste (quand il n’est pas radicalisé), schizophrène, apathique, décérébré, dirigé par une toute petite poignée qui s’accapare 99% de nos richesses naturelles et industrielles, tandis que la classe moyenne s’arroge le monopole de la Bienpensance en déversant sur internet ses accusations et condamnations en tout genre quant à ce que l’on ne doit pas dire, écrire, penser, lire, regarder, manger et baiser, histoire de se contempler dans la glace le soir en ayant l’impression toute virtuelle de faire partie des « gentils », et de servir à quelque chose dans ce monde déglingué, tout en oubliant sciemment ses propres tares.
Depuis 1973, la crise économique s’est installée durablement à la place de la croissance. Le fossé entre riches et pauvres n’a cessé de s’agrandir. Les laissés-pour-compte pullulent davantage à chaque décennie. Les entreprises, banques et autres majors, ennemies ultimes des hippies, semblent avoir définitivement pris le pouvoir. Les hippies eux-mêmes, dès qu’ils ont eu accès aux postes-clés des institutions (voir la biographie édifiante de Jerry Rubin), se sont laissés fondre en elles tout en se préservant hypocritement une once d’apparence rebelle en inventant le « bobo ».
Alors effectivement, vu sous cet angle, l’idéologie prônée par les hippies et leurs successeurs de 68 a foutu davantage la merde qu’elle n’a changé le monde en bien (ah bon ? on a gagné l’écologie ? et les terroristes véganistes, on en fait quoi ?).
N’empêche que cette révolte de la fin des années 60 nous manque. Que font les jeunes aujourd’hui ? Quelles sont leurs revendications ? Qu’attendent-t-ils pour s’imposer, pour contester, pour s’affirmer ? C’est vrai : L’idéologie hippie s’est bien cassé la gueule. Mais face à l’inertie déprimante de la jeunesse actuelle, on peut vraiment se demander laquelle on préfère…
BO du jour
Aucun hippie digne de ce nom n’est passé à côté du premier album de Sweet Smoke. Etrangement, alors qu’il s’agit d’un album de pop music, c’est avec ce dernier que votre serviteur a compris comment dissocier l’écoute de la musique sur chaque instrument, et a découvert le monde du jazz
!
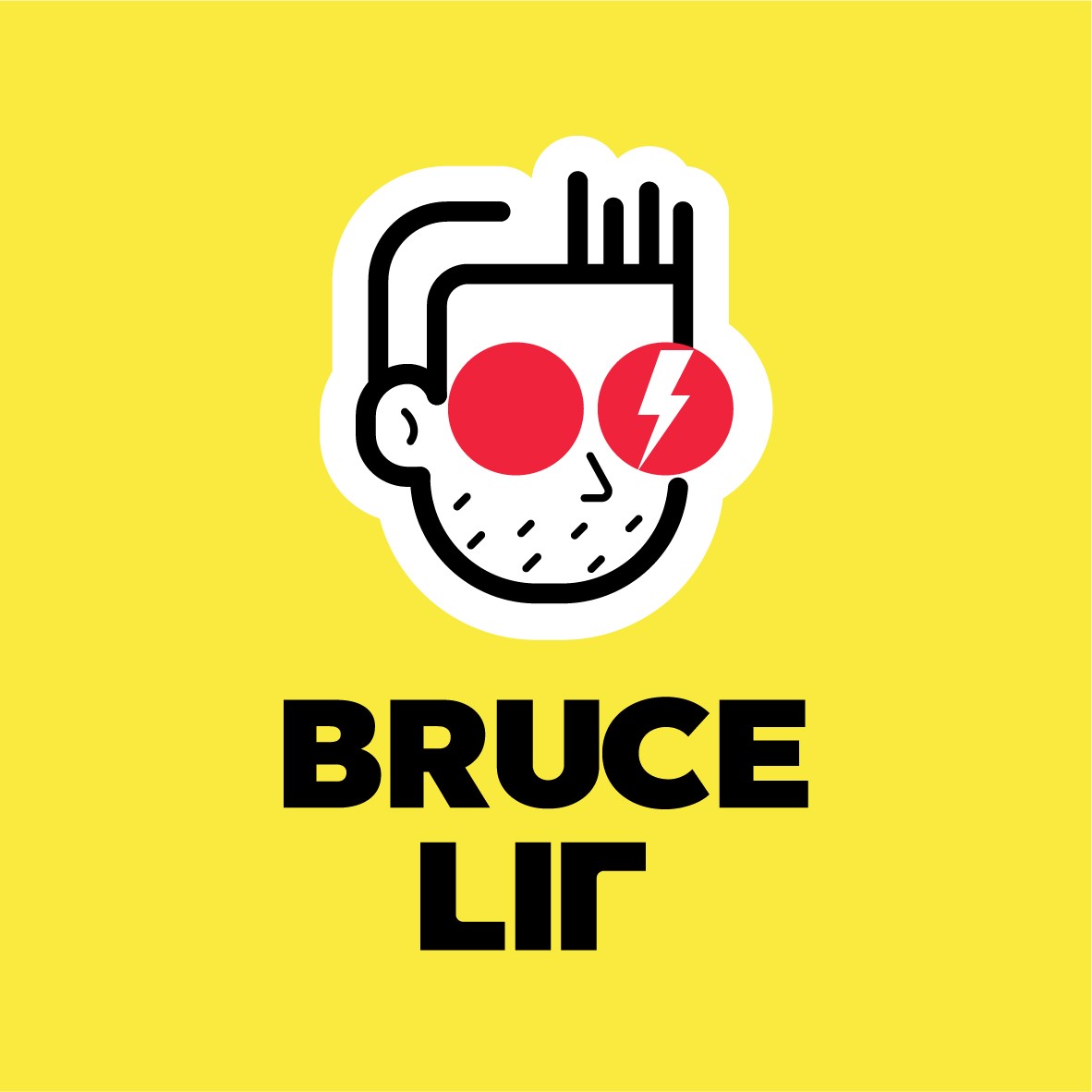
Je suppose qu’il y a plusieurs traductions françaises qui cohabitent.
Faudrait faire une petite enquête pour voir quelle est la plus réussie.
Perso, je l’avais lu en vo et je me souviens l’avoir lu en apnée, complètement fasciné par l’écriture et le propos de Conrad.