Wilson par Daniel Clowes
AUTEUR : PRÉSENCE
Il s’agit d’une histoire complète et indépendante de toute autre, en couleurs. Elle est initialement parue en 2010, écrite, dessinée, encrée et mise en couleurs par Daniel Clowes.
Ce tome se compose de 71 gags en 1 page, mettant tous en scène un petit bonhomme à la calvitie naissante, avec des lunettes, et une misanthropie à toute épreuve.
Wilson n’a pas d’emploi fixe, peut être même pas d’emploi du tout. Il est divorcé depuis plus d’une dizaine d’années. Il est terriblement seul et terriblement hautain et dédaigneux, avec une bonne dose d’égocentrisme.
Le premier gag se déroule alors que Wilson promène son chien et qu’il aborde une femme en train de promener le sien en lui demandant comment ça va.
Dans le suivant, il se promène à pied dans les rues d’Oakland (en Californie), la ville où il réside. Puis la page suivante, il se promène à nouveau seul et à pied en parlant tout seul à haute voix, de nuit, en évoquant le souvenir du décès de sa mère.
Quatrième gag, il promène à nouveau son chien croisant plusieurs personnes s’extasiant dessus. Cinquième gag, dans un café, il prend sa commande au comptoir et va s’asseoir à une table occupé, pour entamer la conversation. À chaque fois, le comique naît de la réflexion finale de Wilson, une courte phrase méprisante ou pensive.
Pour pouvoir apprécier cette lecture dès le début, le lecteur doit avoir à l’esprit qu’il s’agit d’une histoire d’un seul tenant, proposant de suivre la vie Wilson, au travers de 71 instantanés, parfois consécutifs, parfois distants de plusieurs années. Ces 71 pages ont été publiées en album dès la première édition, il n’y a pas eu de prépublication page par page. Le premier tiers des gags sert essentiellement à mettre à jour la personnalité abrasive, pénible et misanthrope de Wilson.
Les premiers gags sont plutôt basiques, entre amertume, mépris et dédain. Il n’y a rien de révolutionnaire ou de particulièrement pénétrant, simplement un personnage acerbe et suffisant, avec lequel il est impossible de sympathiser.
Sans raison apparente, Daniel Clowes fait varier son style de réaliste, à exagéré avec des gros nez et des silhouettes rondouillardes. Visuellement, ces pages sont assez basiques, à la fois par ce qu’elles montrent et par la mise en scène dépouillée : Wilson se promène, il parle à haute voix tout seul pour que le lecteur ait accès à ses pensées.
Selon sa sensibilité, le lecteur pourra être sensible à une vacherie ou à une autre. Le gag intitulé Gate 27 (page 21) est particulièrement pénétrant sur l’impossibilité de comprendre la nature du métier d’un étranger, le manque de sens de ce métier, perdu dans la démultiplication des tâches et une spécialisation toujours plus pointue et absconse pour le béotien.
Petit à petit, les gags deviennent plus personnels, plus liés à la vie de Wilson, plus méchants, plus désespérés, plus révélateurs de la condition humaine. Dans Huddle house (page 35), Daniel Clowes joue avec les codes de la bande dessinée, Wilson s’exprimant à haute voix, sans prêter attention à la serveuse à ses côtés, mais celle-ci à tout entendu et le reconnaît.
D’un point de vue logique, ça ne tient pas debout puisque le lecteur a conscience que ces phrases exprimées à haute voix correspondent au monologue intérieur de Wilson. Mais d’un point de vue narratif, la cohérence est assurée avec les pages précédentes, Clowes jouant sur la convention relative au phylactère, à la fois voix intérieure, et paroles.
Dans Boggie (page 39), Clowes démonte avec cruauté le besoin vital de l’individu d’enjoliver sa réalité pour pouvoir la supporter. À nouveau, la perspicacité de Wilson est aussi affutée qu’insupportable.
Pages 44 et 45, Wilson franchit un nouveau palier dans son égocentrisme, au travers d’une péripétie plausible, accélérant le rythme de la narration, prouvant que Clowes maîtrise les conventions du genre au point de pouvoir mélanger les genres, sans créer de télescopage, ou sans qu’ils se neutralisent. L’intrigue prend un tournant encore plus inattendu dans les pages 54 à 58, en conservant la logique interne du récit, sans que Wilson ne perde de sa suffisance, ou de son pathétisme.
Donc arrivé à la moitié de l’ouvrage, le lecteur a pleinement pris conscience qu’il est dans un véritable récit (malgré sa forme de suite de gag en 1 page), un roman en bonne et due forme consacré à un individu antipathique au possible, mais tellement humain qu’il est impossible de supprimer toute empathie à son endroit.
Avec un peu de recul, les fluctuations de graphisme de réalisme à parodique accompagnent la tonalité des gags pour renforcer l’impression d’une suite de pages indépendantes, pour souligner la nature du gag en 1 page. Elles sont plus des indications sur la tonalité de la narration que sur l’état d’esprit de Wilson.
Elles incitent le lecteur à penser que Daniel Clowes ne se prend pas trop au sérieux et qu’il souhaite que ces pages conservent un bon niveau de divertissement, elles compensent la noirceur de cette solitude sans espoir, d’un individu pleinement conscient de son état sans possibilité d’amélioration.
Daniel Clowes a sciemment choisi une forme déconcertante pour le lecteur : une suite de 71 gags en 1 page, avec des ruptures de style graphique. Cette forme incite le lecteur à prendre chaque page indépendamment des autres, à apprécier chaque gag pour lui-même. Sous cette forme, la lecture de Wilson est une réussite partielle : certains gags sont d’une noirceur désespérante, d’autres sont plus communs.
Mais alors que l’accumulation des pages finit par former une narration plus traditionnelle, le lecteur perçoit le regard sans concession porté sur la condition humaine, d’une terrible noirceur sans fard. Clowes dresse le portrait d’un fat insupportable, d’un être humain en prise directe avec les limites de l’humanité.
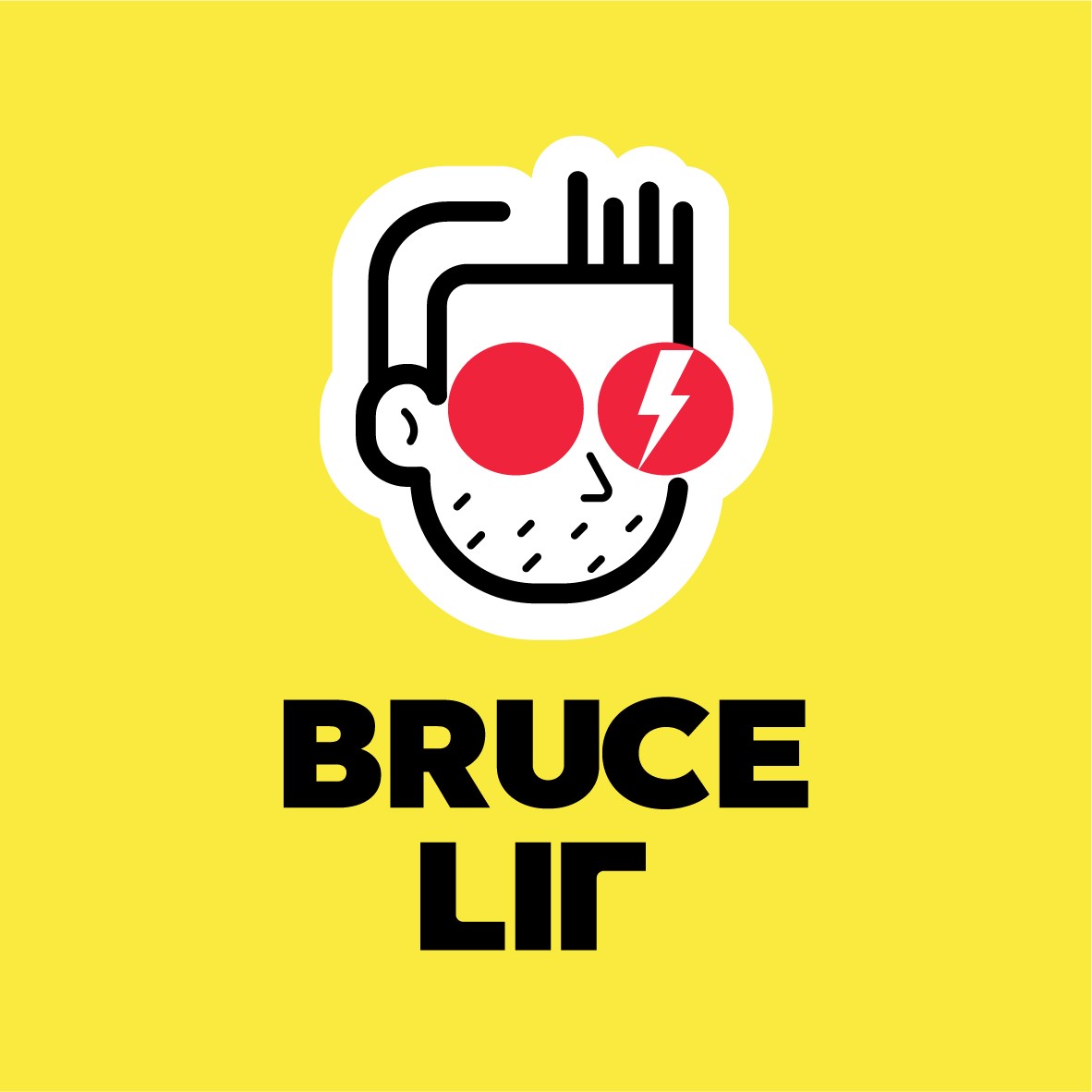
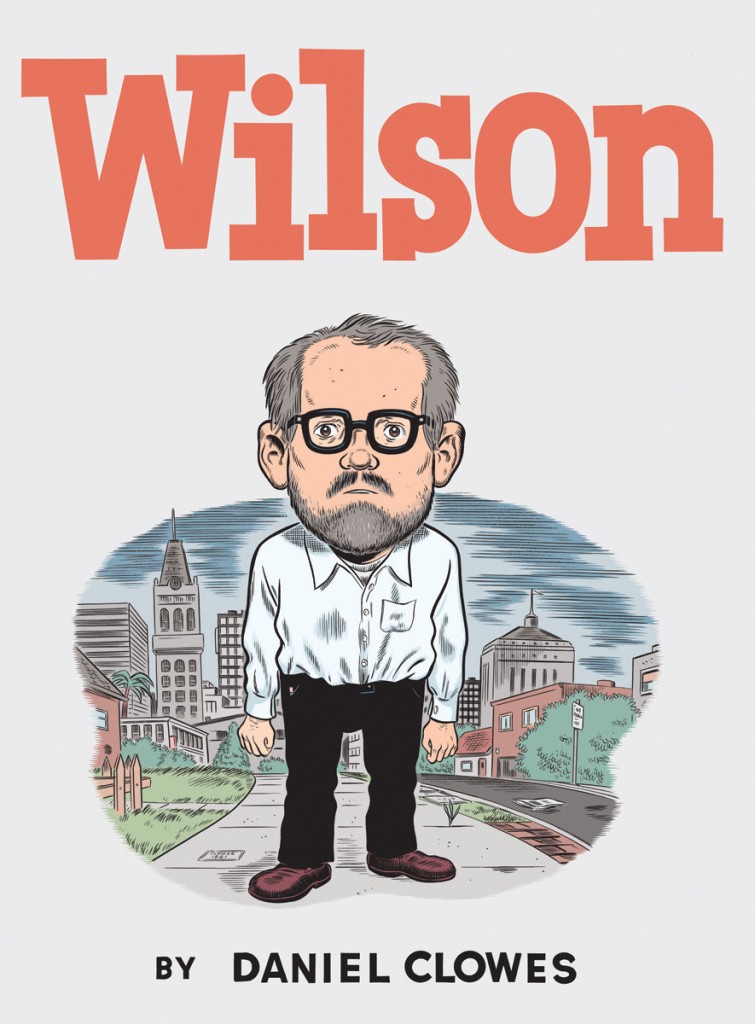



Excellent !! Un grand merci pour ce commentaire très juste qui m’a permis de rencontrer Wilson sous son meilleur jour J’ai pu percevoir dès le début la trame de roman qui se tisse en arrière plan.
J’ai pu percevoir dès le début la trame de roman qui se tisse en arrière plan.
Abject, lucide voire pénétrant, autocentré, méprisant et méprisable… Sincèrement, sans le « surmoi », je crois que certaines de mes conversations pourraient ressembler à cela…. « Mon dieu, les gens vivent de façon si affligeante ! » aurait ajouté Wilson en me regardant…
Mon dieu, les gens vivent de façon si affligeante ! – Une de mes phrases préférées de cette BD. Rapportée à la propre vie de Wilson, elle le condamne encore plus dans son autosuffisance, mais elle le rend également plus pitoyable comme être humain englué dans ses contradictions, limité par ses capacités finies, comme chacun d’entre nous, à commencer par moi.
Je ne sais plus si j’ai lu Ice Haven, mais je n’ai pas lu Mister Wonderful pour sûr. Tous les autres que tu cites sont pour moi de très bonnes bd, des oeuvres uniques et pénétrantes. Il faut que je les relise, tiens.
J’aime beaucoup Wilson car c’est la première fois je trouve qu’il est clair que Clowes se débarasse des influences de Charles Burns (au fait, j’espère que vous avez jeté un oeil, en bon tintinophile, aux derniers Burns sortis chez Cornélius, Toxic et sa suite ? Tornado, c’est pour toi ! Présence aussi) pour s’approcher de Peanuts, surtout dans le ton.
Sinon rien à dire sur le commentaire, just perfect.
Je viens de le finir et décidément je n’aime pas cet auteur. Tous les thèmes et leurs profondeurs que tu évoques y sont. Je trouve les dessins très beaux mais décidément, je ne sais identifier ce qui me rebute chez Clowes. Je ne trouve pas ses gags drôles, certaines chutes me sont apparues plates et je n’ai pas apprécié le format Strip qui hache l’histoire. Pourtant c’est également le même principe que celui du roi des mouches mais que je trouve bcp plus méchant, profond, violent… Wilson a réussit à m’émouvoir lorsqu’il s’écroule sur le terrain de Basket après la mort de son père. Pour tenter de faire une critique argumentée, je dirai que j’ai eu l’impression d’avoir d’avantage à faire à un dessinateur virtuose qu’à un scénariste qui me parle…Je suis bien embarrassé en tout cas de ne pas savoir argumenter.